-
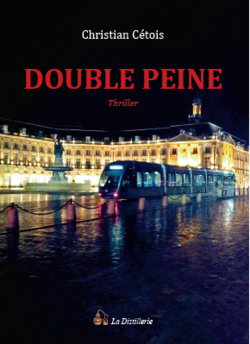 La locution latine « non bis in idem » signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. C’est un principe de droit pénal exprimé à l’article 368 du code de procédure pénale mais qui irradie le droit du travail : un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour une même faute.
La locution latine « non bis in idem » signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. C’est un principe de droit pénal exprimé à l’article 368 du code de procédure pénale mais qui irradie le droit du travail : un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour une même faute.Peu importe que la sanction initialement prononcée soit finalement considérée par l’employeur comme inadaptée, trop légère ou trop lourde : selon la formule consacrée, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut retirer la sanction, sauf accord du salarié.
La Cour de Cassation applique régulièrement ce principe. Ainsi dans une décision du 17 janvier 2018, elle a eu à connaitre du cas d’un agent de sécurité qui contestait son licenciement après avoir d’abord été muté sur un nouveau site. La Cour Suprême lui donne raison au motif « que le comportement fautif du salarié avait déjà été sanctionné par la mutation disciplinaire mis en œuvre par l’employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement » (Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-19.835).
Plus récemment, l’affaire « Alexandre Benalla » permet d’illustrer l’application de ce principe : si l’intéressé a effectivement fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 15 jours pour les faits commis place de la Contrescarpe le 1er mai 2018 alors, son licenciement ensuite annoncé sous la pression médiatique, en raison des mêmes faits, serait nécessairement abusif … à moins que celui-ci vienne sanctionner de nouveaux faits.
Me Manuel Dambrin
-
 C’est une décision inédite que vient de rendre la Cour de Cassation, en posant pour la première fois que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes », sans porter excessivement atteinte aux droits de la défense (Cass. Soc., 4 juillet 2018, n° 17-18241).
C’est une décision inédite que vient de rendre la Cour de Cassation, en posant pour la première fois que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes », sans porter excessivement atteinte aux droits de la défense (Cass. Soc., 4 juillet 2018, n° 17-18241).Il s’agissait en l’occurrence d’un salarié de la SNCF qui avait été licencié sur la base d’un rapport de la direction de l’éthique de la société, lequel se fondait sur des témoignages anonymes.
La Cour d’appel avait validé le licenciement en jugeant que l’atteinte aux droits de la défense n’était pas justifiée dans la mesure où le salarié avait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport et de présenter ses observations.
A tort selon la Cour de Cassation, qui estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit d’avoir un procès équitable.
Si en matière prud’homale la preuve est dite « libre » en ce sens que les parties peuvent rapporter la preuve de leurs allégations par tout moyen et notamment par des témoignages, ces derniers doivent respecter un certain formalisme et comporter la mention des noms et prénoms du témoin.
Me Manuel Dambrin
-
 Le fait pour un salarié d’utiliser son temps de travail à d’autres tâches que celles pour lesquelles il est payé, peut constituer le délit d’abus de confiance. C’est ce qu’a jugé la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 mai 2018 (n° 16-86369).
Le fait pour un salarié d’utiliser son temps de travail à d’autres tâches que celles pour lesquelles il est payé, peut constituer le délit d’abus de confiance. C’est ce qu’a jugé la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 mai 2018 (n° 16-86369).Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, deux salariés avaient, sur leur temps de travail et à l’aide des moyens mis à leur disposition (locaux, téléphone, outil informatique) créé et développé une activité commerciale pour le compte de sociétés tierces à leur employeur.
Informé de ces faits, l’employeur aurait pu se contenter d’en tirer, classiquement, des conséquences disciplinaires, en prononçant le licenciement pour faute grave ou lourde des intéressés, dont les agissements, s’ils étaient avérés, constituaient un manquement à l’obligation de loyauté qui est inhérente à l’exécution de tout contrat de travail.
Mais l’employeur dénonçait également ces agissements au Procureur de la République et, à l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction renvoyait les deux salariés devant le Tribunal correctionnel. Aux termes de la procédure judiciaire, la Cour d’appel retenait l’existence d’un abus de confiance et prononçait des peines d’emprisonnement avec sursis, d’un an et de six mois, contre les salariés.
Cette solution est approuvée par la Cour de Cassation qui énonce « que constitue le délit d'abus de confiance l'utilisation, par des salariés, de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur ».
La solution a de quoi surprendre car l’abus de confiance se définit strictement par « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (art. 314-1 du code pénal).
« Le temps de travail » ne pouvant être qualifié ni de « fonds » ni de « valeurs » au sens de ce texte, il constituerait donc un « bien quelconque », ce qui est assez audacieux au regard de la définition classique d’un bien : « toute chose matérielle susceptible d’appropriation » (Cornu G., vocabulaire juridique).
Surtout, l’abus de confiance suppose que le bien quelconque, objet du détournement, a préalablement « été remis » à l’auteur du détournement. Il faut donc considérer que l’employeur est propriétaire du temps de travail de ses salariés et que ce temps ferait l’objet d’une remise préalable au salarié…
Bref, cette solution, et sa formulation très large dans l’arrêt évoqué ci-dessus est contestable au regard du principe d’interprétation stricte de la norme pénale et pourrait ouvrir la voie à une certaine insécurité juridique : à partir de quelle durée la pause-café ou le temps passé sur internet à préparer ses vacances dégénère-t-il en abus de confiance ?
Me Manuel Dambrin
-
La réduction de la vitesse maximale de 90 km/heures à 80 km/heures semble inattaquable car elle est supposée réduire la mortalité routière.
Cette seule invocation des vies sauvées est sensée évacuer toute discussion sérieuse, et discréditer ceux qui s’aventurent à émettre des objections.
On se hasardera pourtant à les formuler ici, car cette question a priori banale traduit des tendances qui s’expriment aussi dans bien d’autres domaines.
1/ Cette mesure est imputable à la tentation classique de l’Etat de protéger les citoyens contre eux-mêmes et de juger légitime toute restriction de liberté destinée à atteindre une fin jugée préférable. Là où l’Etat pourrait se borner à informer et à se porter garant de la protection des plus faibles, il préfère interdire, punir, et traiter chacun d’entre nous en mineurs éternels. Big Brother sait ce qui est bon pour nous, merci Big Brother.
2/ Cette mesure trahit la préférence de traitement des problèmes par des mesures simples, sur lesquelles il est aisé de communiquer, par rapport à des mesures plus subtiles, mais moins visibles. En réduisant la vitesse maximale, le Gouvernement a fait le choix de la facilité. Il est incontestable que des progrès considérables ont été accomplis en matière de sécurité routière, les nombre de décès sur les routes étant passé de 18.000 morts par an en 1972 à 3.477 par an en 2016. Il va de soi que la vitesse constitue un facteur aggravant de la dangerosité des chocs, mais cet argument ne suffit pas à épuiser le débat, ou alors il faut passer la vitesse maximale à 70 km / heure sur routes et 100 km / heure sur autoroutes.
La réalité est que la vitesse n’est que l’un des facteurs de mortalité routière et que l’on pourrait envisager de lutter plus sérieusement contre l’alcool au volant, contre la conduite sous l’emprise de stupéfiants, contre les imprudences incroyables des cyclistes (qui semblent jouir d’une impunité totale) et des motards. Il faudrait aussi investir dans la qualité de la chaussée, très sérieusement dégradée en région parisienne et ailleurs en France.
Moins simple et moins visible que la réduction de la vitesse maximale sur route.
3/ Cette mesure trahit une conception verticale et centralisatrice du pouvoir. D’une part, il aurait été possible de ne réduire la vitesse que sur les portions de route le nécessitant véritablement sans passer par une mesure aussi générale. D’autre part, l’Etat aurait pu laisser les collectivités territoriales décider de la vitesse maximale sur les portions dans leur dépendance, mais elles ne sont visiblement pas considérées comme capables de décider d’un sujet aussi concret.
4/ Cette mesure constitue une preuve supplémentaire de l’acharnement formidable visant l’automobile et les automobilistes entre hausse de la fiscalité des carburants, multiplication des radars, renforcement formidable du contrôle technique : tout est fait pour inciter les automobilistes à vendre leur véhicule et à prendre les transports en commun.
On applaudirait des deux mains s’il existait des alternatives sérieuses à l’automobile.
Pourtant, force est de constater que, même en région parisienne, les transports en commun sont sujets à grèves, desservent mal les trajets banlieue/banlieue, et ne constituent pas une alternative parfaite à l’automobile. Il en va évidemment d’autant plus en province ou l’automobile est et restera indispensable.
*
L’hostilité gouvernementale à l’automobile et aux automobilistes est tellement irrationnelle que l’on finit par se demander si elle ne s’explique pas par un certain éloignement du gouvernement par rapport aux préoccupations quotidiennes des Français, interrogation qui pourrait s’expliquer par le constat du fait que 11 ministres ne possèdent pas d’automobile, et qu’il en va de même du président de la République et le premier ministre.
Me Xavier Chabeuf
 Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires


