-
S’endormir sur son lieu de travail, particulièrement lorsque l’on est chargé de la surveillance d’un site, constitue assurément une faute grave, en principe …
C’est ce qu’avait soutenu l’employeur, la société Securitas France, pour licencier le salarié qui, chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux d'une entreprise, avait été retrouvé endormi à son poste de travail, l'accès aux locaux étant laissé entièrement libre et une clé des locaux étant posée devant lui à la portée de tous.
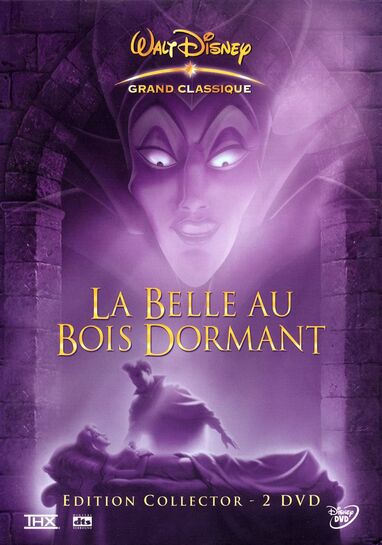
A tort selon la Cour de Cassation puisqu’en effet, ayant relevé que l'endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-17.680 FS-PB).
Rappelons en effet que l'article L. 3121-35 du Code du travail fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine.
Me Manuel Dambrin
-
 L’une des mesures phares de la réforme du droit du travail de septembre 2017 résidait dans le plafonnement des indemnités prud’homales ou, plus précisément dans le fait d’encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués par le juge en cas de licenciement jugé abusif, entre un minimum et un maximum (entre un et 20 mois de salaire), en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise au moment du licenciement.
L’une des mesures phares de la réforme du droit du travail de septembre 2017 résidait dans le plafonnement des indemnités prud’homales ou, plus précisément dans le fait d’encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués par le juge en cas de licenciement jugé abusif, entre un minimum et un maximum (entre un et 20 mois de salaire), en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise au moment du licenciement.Le dispositif, très critiqué comme portant atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice et au pouvoir des juges d’évaluer souverainement, et au cas par cas, le montant des indemnités à verser par l'employeur, avait cependant été validé par le Conseil Constitutionnel, qui avait jugé notamment « que le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi » (Cons. const. 7 sept. 2017, n° 2017-751 DC, consid. 37).
Mais le débat n’était pas clos pour autant car si en droit interne, la messe était dite, restait à trancher la conventionalité du dispositif, c’est-à-dire sa conformité au regard des conventions internationales.
Par conventions internationales en l’espèce, il faut entendre principalement l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Selon le premier de ces textes : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention [les tribunaux] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Et selon le second : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties [les Etats] s’engagent à reconnaître […] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
« Une réparation appropriée » ou une « indemnité adéquate », voilà des notions qui ne seraient pas compatibles avec la « barémisation » des indemnités imposées au juge.
C’est ce que décide la décision rendue le 13 décembre 2018 (n° 18/00036) par le Conseil de Prud'hommes de Troyes qui, pour écarter le barème, mobilise l’article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que le principe du droit au procès équitable.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le juge a alloué au salarié une indemnité correspondant à neuf mois de salaire, là où l’application du barème ne lui permettait de prétendre qu’à une indemnité correspondant à quatre mois au plus à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conseils de prud'hommes d'Amiens (19 décembre 2018) et de Lyon (21 décembre 2018) ont emboîté le pas à celui de Troyes en rendant des décisions similaires en refusant d'appliquer le barème jugé contraire au droit international.
La portée de ces décisions est sujette à interrogation. Que dira la Cour d’appel qui sera sans doute saisie et, après elle, la Cour de Cassation ?
Me Manuel Dambrin
-
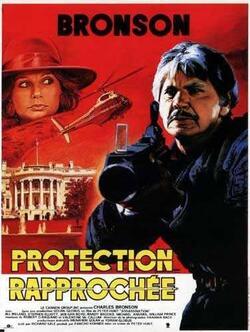 Pendant l’arrêt de travail, quel que soit son origine (accident du travail, maladie professionnelle ou non), le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie que le salarié n’est pas tenu d’effectuer sa prestation de travail ou, plus exactement, qu’il lui est interdit de continuer à travailler, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par sa CPAM.
Pendant l’arrêt de travail, quel que soit son origine (accident du travail, maladie professionnelle ou non), le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie que le salarié n’est pas tenu d’effectuer sa prestation de travail ou, plus exactement, qu’il lui est interdit de continuer à travailler, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par sa CPAM.Seule est maintenue durant cette suspension du contrat de travail, l’obligation de loyauté, qui interdit au salarié de causer du tort à son employeur, notamment en exerçant une activité concurrence.
Le niveau de protection dont bénéficie le salarié n’est pas le même selon l'origine de l’arrêt de travail.
Si celui-ci est dû à une maladie ou à un accident non professionnel (grippe, accident domestique,…), le licenciement est possible. Aucun texte, en effet, n’interdit le licenciement d’un salarié en arrêt de travail, que ce soit pour motif économique ou pour motif personnel, à raison de fait commis antérieurement à l’arrêt de travail ou durant celui-ci.
Si en revanche l’arrêt de travail est dû à une maladie ou à un accident professionnel, le licenciement est, par principe, interdit, sauf dans deux hypothèses : la faute grave et l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie (Articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail).
Si le licenciement est prononcé pour une autre cause, ou bien s’il est prononcé pour l’une de ces causes mais que le juge décide que la faute grave (ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie) n’est pas caractérisée, la sanction tombe : le licenciement est nul.
Cette sanction ouvre un droit d’option pour le salarié, qui peut alors choisir entre, soit sa réintégration au sein de l’entreprise (assortie d’une indemnité compensatrice des salaires échus depuis le licenciement nul jusqu’à sa réintégration), soit une indemnisation, laquelle ne peut dans ce cas être inférieure à 6 mois de salaire, quelque soit l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
La sévérité de ces sanctions pourra inciter l’employeur à contester, devant la CPAM puis les juridictions de sécurité sociale, la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle, pour faire « tomber » le statut protecteur attaché à ce statut.
Me Manuel Dambrin
-
En 1453, alors que les troupes ottomanes s’apprêtaient à entrer dans Constantinople, les religieux byzantins étaient occupés à discuter de la question théologique du sexe des anges, facilitant la chute de la ville et de l’Empire romain d’Orient.
Le 2 octobre 2018, la garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, a adressé à ses services et à tous les plus hauts magistrats du pays une note précisant la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel.
On est heureux de constater que face à l’explosion de la population carcérale, aux difficultés matérielles rencontrées par les juridictions, le ministre trouve encore l’énergie pour pousser les feux d’une bataille symbolique visant à la féminisation des fonctions dans l’institution judiciaire.
Ce d’autant que désormais les femmes sont très majoritairement majoritaires dans cette administration, et que chaque nouvelle promotion de l’Ecole nationale de la magistrature renforce encore la proportion de femmes dans la magistrature et dans les greffes.
Il ne s’agit pas ici de contester ici l’impératif évident de l’égalité hommes/femmes dans l’accès aux responsabilités et dans l’évolution des carrières, mais simplement de s’interroger sur la question de savoir si ce combat légitime doit passer par la violation des règles de grammaire de la langue française.
Et la note en question ne rassure pas de ce point de vue, qu’on en juge.
Ainsi le (la ?) ministre préconise, dans les textes réglementaires, l’usage du masculin en tant que forme neutre pour les termes susceptibles de concerner les femmes comme les hommes.
En revanche, elle demande que les mentions désignant la personne titulaire de la fonction soient accordées en genre. On parlera donc de « l’auteure », « la ministre », « la secrétaire générale », « la directrice », « la procureure », « la greffière ».
A titre facultatif, en fonction du souhait du chef de cour, il sera possible d’écrire « la cheffe » ou « la substitute ».
En tout état de cause, il est recommandé dans la note de recueillir au préalable l’avis des intéressées…
Il faut donc comprendre que l’on passera de formulations bien établies par des siècles de pratique, conformes aux préconisations de l’Académie française, et faisant du masculin le genre neutre s’appliquant aussi bien aux femmes qu’aux hommes lorsque l’on désigne des fonctions officielles, à un usage différencié selon les juridictions et même selon les magistrates en fonction de leurs préférences personnelles.
Autant dire que la diversité des pratiques risque de se répandre, ce qui multipliera faux pas et offenses involontaires.
Cela arrive déjà parfois, et l’avocat de s’interroger, en début d’audience, s’il doit s’adresser au chef de la formation de jugement en lui disant « Madame le Président » ou « Madame la Présidente ». Il convient alors d’essayer de deviner l’inclinaison du magistrat, au risque de se faire reprendre sèchement, ce qui constitue un bien mauvais début de plaidoirie.
La France s’est constituée en large partie par le partage d’une langue qui permettait aux Français de communiquer entre eux. Et il n’est pas anodin que le premier texte officiel rendant obligatoire l’usage de la langue française dans l’administration ait visé à l’application du français dans les décisions de justice (ordonnance de Villers-Cotterêt, 1539, encore en vigueur).
Qu’en est-il lorsque le langage judiciaire ne vise plus à l’universalisme mais au soulignement des particularismes, ou lorsque les règles de grammaire sont fonction du contexte et de la personne à qui l’on s’adresse ?
Le byzantinisme n’est pas loin.
Me Xavier Chabeuf
 Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires



