-
 Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2018 (N°17-20691) vient, discrètement mais sûrement, rappeler que la qualité de « cadre » (par opposition à celles d’ouvrier, d’employé, de technicien ou d’agent de maîtrise) n’exclut pas l’accomplissement et le paiement d’heures supplémentaires.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2018 (N°17-20691) vient, discrètement mais sûrement, rappeler que la qualité de « cadre » (par opposition à celles d’ouvrier, d’employé, de technicien ou d’agent de maîtrise) n’exclut pas l’accomplissement et le paiement d’heures supplémentaires.Ce n’est pas, en effet, la classification de « cadre » qui exclut le paiement des heures supplémentaires, mais le dispositif, dérogatoire à la durée légale du travail (35h) éventuellement mis en place – si les conditions le permettent -, qui affranchit l’employeur du paiement des heures supplémentaires : les conventions de forfait en heures ou en jours.
Le « cadre » est, par défaut, un salarié assujetti aux 35 heures hebdomadaires et peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires, à moins qu’il n’ait signé une convention individuelle de forfait et que cette convention respecte un certain nombre de conditions de forme et de fond (cf précédentes parutions sur ce blog).
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité, le salarié qui était « cadre », sollicitait un rappel d’heures supplémentaires et, pour en limiter le nombre, la cour d’appel avait retenu « que la reconnaissance du statut de cadre et l'impact que cela peut avoir sur la réalisation d'heures supplémentaires, à défaut de pointage, pour des salariés autonomes et susceptibles de se déplacer, ne plaçait pas le salarié en position d'obtenir gain de cause ».
Cette motivation allait au-devant d’une censure certaine, qui est intervenue par l’arrêt susvisé qui énonce « que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ».
Me Manuel Dambrin
-
 Le salarié est tenu envers son employeur et durant l’exécution de son contrat de travail, d’une obligation de loyauté qui découle du contrat de travail, sans avoir à y figurer expressément. Cela impose au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur, et ce même pendant les périodes de suspension du contrat de travail, tel que les arrêts de travail.
Le salarié est tenu envers son employeur et durant l’exécution de son contrat de travail, d’une obligation de loyauté qui découle du contrat de travail, sans avoir à y figurer expressément. Cela impose au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur, et ce même pendant les périodes de suspension du contrat de travail, tel que les arrêts de travail.Le fondement juridique de cette obligation se trouve à l’article L1222-1 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
C’est sur cette obligation de loyauté que s’était fondée une entreprise de stockage informatique pour licencier un salarié à qui elle reprochait d’avoir créé une société hôtelière, qu’il exploitait en tant que gérant pendant ses congés maladie, faits que l’intéressé n’étaient pas parvenu à contester et qui étaient donc acquis aux débats.
L’employeur estimait que ce licenciement était justifié en ce que l'exercice d'une activité professionnelle, même non concurrente à la sienne, pendant un congé maladie, constituait un manquement fautif à l'obligation de loyauté, préjudiciable à l'employeur.Et bien pas nécessairement !
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise » (Cass. Soc., 21 novembre 2017, 16-28513).
A cet égard, l’employeur soutenait aussi que, hors périodes d’arrêts de travail, le salarié était « difficilement joignable et peu transparent sur son emploi du temps », qu'il avait utilisé le matériel de l'entreprise et avait passé de nombreux appels téléphoniques pour son autre activité bien qu'il était stipulé dans son contrat de travail qu'il s'engageait à consacrer la totalité de son temps de travail à l'exécution de ses fonctions.
Mais ces arguments n’ont pas convaincu les juges qui, pour juger le licenciement abusif, ont retenu, d’une part, que « la société qui n'apportait pas la preuve que le salarié ait perçu une rémunération de son activité de gérant de la SARL ne pouvait valablement lui opposer la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail » et, d’autre part, que « l'implication du salarié dans la constitution de la SARL Le Chalet des Domaines de la Vanoise ne constituait pas une activité concurrente à celle de la société employeur, leader mondial de stockage informatique, et n'était pas de nature à lui porter préjudice ».
Me Manuel Dambrin
-
 Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur doit dénoncer l’identité et l’adresse du salarié qui a commis, avec un véhicule appartenant à l’entreprise, une infraction routière constatée par radar automatique, tel qu’un excès de vitesse, une situation de téléphone au volant ou le non-respect des feux de signalisation.
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur doit dénoncer l’identité et l’adresse du salarié qui a commis, avec un véhicule appartenant à l’entreprise, une infraction routière constatée par radar automatique, tel qu’un excès de vitesse, une situation de téléphone au volant ou le non-respect des feux de signalisation.C’est ce que prévoit l’article L121-6 du code de la route qui énonce : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».
Le texte ajoute que « Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 11 décembre 2018 (n° 18-82628) vient préciser qui est redevable de cette amende : l’entreprise ou son représentant légal ?
Dans cette affaire, le salarié avait commis un excès de vitesse avec un véhicule de l’entreprise et l’employeur avait refusé de transmettre son identité et son adresse aux autorités. Un avis de contravention pour non-désignation avait alors été adressé, mais au nom et à l’adresse de l’entreprise (personne morale).
Celle-ci avait alors formé un recours, considérant qu’elle ne pouvait être poursuivie pour non-respect de l’obligation de désignation.
Le tribunal de police lui a donné raison en estimant que les faits reprochés ne pouvaient pas être imputés à l’entreprise mais uniquement à son représentant légal (personne physique).
La Cour de cassation n’est pas du même avis : Elle considère que si l’employeur peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de désignation, l’entreprise peut l’être tout autant, ce qui permet une répression plus efficace puisque l’amende encourue par l’entreprise s’élève à 3 750 €, contre 750 € pour son représentant personne physique…
Me Manuel Dambrin
-
Depuis la loi du 30 juillet 2018, le le secret des affaires, entendu comme la protection d’informations économiques et techniques confidentielles des entreprises, est protégé en droit français. Ce texte transpose en droit français une directive communautaire du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales.
L’idée de la protection est que les entreprises disposent de « secrets » qu’elles ne souhaitent pas voir divulgués à leur concurrent et au grand public : données commerciales ou financières, organisation de l’entreprise, informations relatives aux clients ou au marché, aux prix pratiqués, plans et stratégies de développement.
L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée comme étant celle qui n’est pas librement accessible, « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle », « fait l’objet de son détenteur légitime de mesures de protections raisonnables ».
Cette belle idée sera cependant d’application concrète difficile :
D’une part, la définition d’une information « secrète », donc protégée par l’entreprise, devra être circonscrite par la jurisprudence et il faut donc s’attendre à des années d’incertitude avant que les contours de la notion ne soient stabilisés ;
D’autre part, l’article L. 151-4 du code de commerce considère comme illicite l’obtention du secret réalisée sans le consentement de son détenteur légitime ou résultant d’un accès non autorisé, ou lorsque la personne savait ou aurait dû savoir que le secret avait été obtenu d’une personne qui avait divulgué le secret de manière illicite : si les deux premiers cas résultent d’une violation claire, le troisième l’est beaucoup moins, lorsque le secret est « de seconde main » et qu’il faudrait savoir qu’il n’aurait pas dû être communiqué ;
Enfin, les limites au secret des affaires sont nombreuses : la liberté d’expression et la liberté d’information (Elise Lucet pourra continuer à dévoiler les pratiques « condamnables » de certaines grandes entreprises), l’activité des « lanceurs d’alerte » visant à protéger l’intérêt général ; la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national (vaste catégorie fourre-tout permettant de limiter le nouveau droit dans des proportions significatives).
Mais l’inconnue majeure reste, notamment pour l’avocat pratiquant le contentieux commercial, de savoir si ce nouveau secret limitera sa liberté d’action !
En l’absence d’une procédure de Discovery comparable à ce qui existe aux Etats-Unis, la prime revient souvent en France à la partie qui saura le mieux résister à la communication des pièces nécessaires à la résolution du litige. Les pièces qui ne vont pas dans le sens de son argumentation, cela s’entend. Et le secret des affaires était déjà bien souvent brandi par une partie pour faire obstacle à la demande d’injonction de communiquer des pièces formulée auprès du juge, avec des fortunes diverses.
Qu’en sera-t-il demain ? Suffira-t-il d’invoquer le secret des affaires pour empêcher une partie tierce à la société d’avoir accès à des documents internes à celle-ci (ancien salarié, concurrent, fournisseur, banquier, …) ?
Ce serait par trop facile, mais l’on peut d’ores et déjà prédire que les plaideurs auront à cœur de tester les limites de cette nouvelle notion.
L’article L. 153-1 a bien prévu un dispositif supposé concilier exercice des droits de la défense, accès au Tribunal et respect du secret des affaires, mais ses dispositions byzantines apparaissent naïves et contradictoires :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Or le principe du contradictoire et son corollaire, la discussion par chacune des parties des pièces produites par l’autre partie à l’appui de son argumentation, s’opposent radicalement à ce que certaines pièces produites soient cellées à la partie adverse pour être réservées au juge, ou encore soient tronquées ou interprétées par un tiers.
Quant à décider que les débats aient lieu en chambre du conseil, c’est signifier qu’il n’y a pas de secret des affaires, car celui-ci aura été communiqué à la partie adverse et l’essentiel des échanges entre les parties devant le tribunal s’effectue par écrit.
Bref, il est à craindre que cette reconnaissance d’un secret des affaires en droit français ne constitue qu’un progrès bien illusoire.
Me Xavier Chabeuf
-
S’endormir sur son lieu de travail, particulièrement lorsque l’on est chargé de la surveillance d’un site, constitue assurément une faute grave, en principe …
C’est ce qu’avait soutenu l’employeur, la société Securitas France, pour licencier le salarié qui, chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux d'une entreprise, avait été retrouvé endormi à son poste de travail, l'accès aux locaux étant laissé entièrement libre et une clé des locaux étant posée devant lui à la portée de tous.
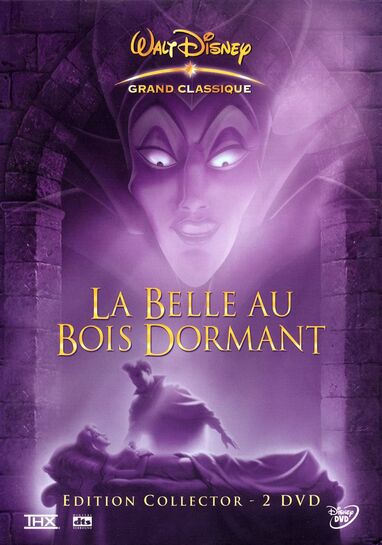
A tort selon la Cour de Cassation puisqu’en effet, ayant relevé que l'endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-17.680 FS-PB).
Rappelons en effet que l'article L. 3121-35 du Code du travail fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine.
Me Manuel Dambrin
-
 L’une des mesures phares de la réforme du droit du travail de septembre 2017 résidait dans le plafonnement des indemnités prud’homales ou, plus précisément dans le fait d’encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués par le juge en cas de licenciement jugé abusif, entre un minimum et un maximum (entre un et 20 mois de salaire), en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise au moment du licenciement.
L’une des mesures phares de la réforme du droit du travail de septembre 2017 résidait dans le plafonnement des indemnités prud’homales ou, plus précisément dans le fait d’encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués par le juge en cas de licenciement jugé abusif, entre un minimum et un maximum (entre un et 20 mois de salaire), en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise au moment du licenciement.Le dispositif, très critiqué comme portant atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice et au pouvoir des juges d’évaluer souverainement, et au cas par cas, le montant des indemnités à verser par l'employeur, avait cependant été validé par le Conseil Constitutionnel, qui avait jugé notamment « que le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi » (Cons. const. 7 sept. 2017, n° 2017-751 DC, consid. 37).
Mais le débat n’était pas clos pour autant car si en droit interne, la messe était dite, restait à trancher la conventionalité du dispositif, c’est-à-dire sa conformité au regard des conventions internationales.
Par conventions internationales en l’espèce, il faut entendre principalement l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Selon le premier de ces textes : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention [les tribunaux] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Et selon le second : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties [les Etats] s’engagent à reconnaître […] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
« Une réparation appropriée » ou une « indemnité adéquate », voilà des notions qui ne seraient pas compatibles avec la « barémisation » des indemnités imposées au juge.
C’est ce que décide la décision rendue le 13 décembre 2018 (n° 18/00036) par le Conseil de Prud'hommes de Troyes qui, pour écarter le barème, mobilise l’article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que le principe du droit au procès équitable.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le juge a alloué au salarié une indemnité correspondant à neuf mois de salaire, là où l’application du barème ne lui permettait de prétendre qu’à une indemnité correspondant à quatre mois au plus à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conseils de prud'hommes d'Amiens (19 décembre 2018) et de Lyon (21 décembre 2018) ont emboîté le pas à celui de Troyes en rendant des décisions similaires en refusant d'appliquer le barème jugé contraire au droit international.
La portée de ces décisions est sujette à interrogation. Que dira la Cour d’appel qui sera sans doute saisie et, après elle, la Cour de Cassation ?
Me Manuel Dambrin
-
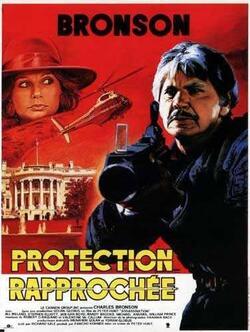 Pendant l’arrêt de travail, quel que soit son origine (accident du travail, maladie professionnelle ou non), le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie que le salarié n’est pas tenu d’effectuer sa prestation de travail ou, plus exactement, qu’il lui est interdit de continuer à travailler, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par sa CPAM.
Pendant l’arrêt de travail, quel que soit son origine (accident du travail, maladie professionnelle ou non), le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie que le salarié n’est pas tenu d’effectuer sa prestation de travail ou, plus exactement, qu’il lui est interdit de continuer à travailler, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par sa CPAM.Seule est maintenue durant cette suspension du contrat de travail, l’obligation de loyauté, qui interdit au salarié de causer du tort à son employeur, notamment en exerçant une activité concurrence.
Le niveau de protection dont bénéficie le salarié n’est pas le même selon l'origine de l’arrêt de travail.
Si celui-ci est dû à une maladie ou à un accident non professionnel (grippe, accident domestique,…), le licenciement est possible. Aucun texte, en effet, n’interdit le licenciement d’un salarié en arrêt de travail, que ce soit pour motif économique ou pour motif personnel, à raison de fait commis antérieurement à l’arrêt de travail ou durant celui-ci.
Si en revanche l’arrêt de travail est dû à une maladie ou à un accident professionnel, le licenciement est, par principe, interdit, sauf dans deux hypothèses : la faute grave et l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie (Articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail).
Si le licenciement est prononcé pour une autre cause, ou bien s’il est prononcé pour l’une de ces causes mais que le juge décide que la faute grave (ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie) n’est pas caractérisée, la sanction tombe : le licenciement est nul.
Cette sanction ouvre un droit d’option pour le salarié, qui peut alors choisir entre, soit sa réintégration au sein de l’entreprise (assortie d’une indemnité compensatrice des salaires échus depuis le licenciement nul jusqu’à sa réintégration), soit une indemnisation, laquelle ne peut dans ce cas être inférieure à 6 mois de salaire, quelque soit l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
La sévérité de ces sanctions pourra inciter l’employeur à contester, devant la CPAM puis les juridictions de sécurité sociale, la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle, pour faire « tomber » le statut protecteur attaché à ce statut.
Me Manuel Dambrin
-
En 1453, alors que les troupes ottomanes s’apprêtaient à entrer dans Constantinople, les religieux byzantins étaient occupés à discuter de la question théologique du sexe des anges, facilitant la chute de la ville et de l’Empire romain d’Orient.
Le 2 octobre 2018, la garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, a adressé à ses services et à tous les plus hauts magistrats du pays une note précisant la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel.
On est heureux de constater que face à l’explosion de la population carcérale, aux difficultés matérielles rencontrées par les juridictions, le ministre trouve encore l’énergie pour pousser les feux d’une bataille symbolique visant à la féminisation des fonctions dans l’institution judiciaire.
Ce d’autant que désormais les femmes sont très majoritairement majoritaires dans cette administration, et que chaque nouvelle promotion de l’Ecole nationale de la magistrature renforce encore la proportion de femmes dans la magistrature et dans les greffes.
Il ne s’agit pas ici de contester ici l’impératif évident de l’égalité hommes/femmes dans l’accès aux responsabilités et dans l’évolution des carrières, mais simplement de s’interroger sur la question de savoir si ce combat légitime doit passer par la violation des règles de grammaire de la langue française.
Et la note en question ne rassure pas de ce point de vue, qu’on en juge.
Ainsi le (la ?) ministre préconise, dans les textes réglementaires, l’usage du masculin en tant que forme neutre pour les termes susceptibles de concerner les femmes comme les hommes.
En revanche, elle demande que les mentions désignant la personne titulaire de la fonction soient accordées en genre. On parlera donc de « l’auteure », « la ministre », « la secrétaire générale », « la directrice », « la procureure », « la greffière ».
A titre facultatif, en fonction du souhait du chef de cour, il sera possible d’écrire « la cheffe » ou « la substitute ».
En tout état de cause, il est recommandé dans la note de recueillir au préalable l’avis des intéressées…
Il faut donc comprendre que l’on passera de formulations bien établies par des siècles de pratique, conformes aux préconisations de l’Académie française, et faisant du masculin le genre neutre s’appliquant aussi bien aux femmes qu’aux hommes lorsque l’on désigne des fonctions officielles, à un usage différencié selon les juridictions et même selon les magistrates en fonction de leurs préférences personnelles.
Autant dire que la diversité des pratiques risque de se répandre, ce qui multipliera faux pas et offenses involontaires.
Cela arrive déjà parfois, et l’avocat de s’interroger, en début d’audience, s’il doit s’adresser au chef de la formation de jugement en lui disant « Madame le Président » ou « Madame la Présidente ». Il convient alors d’essayer de deviner l’inclinaison du magistrat, au risque de se faire reprendre sèchement, ce qui constitue un bien mauvais début de plaidoirie.
La France s’est constituée en large partie par le partage d’une langue qui permettait aux Français de communiquer entre eux. Et il n’est pas anodin que le premier texte officiel rendant obligatoire l’usage de la langue française dans l’administration ait visé à l’application du français dans les décisions de justice (ordonnance de Villers-Cotterêt, 1539, encore en vigueur).
Qu’en est-il lorsque le langage judiciaire ne vise plus à l’universalisme mais au soulignement des particularismes, ou lorsque les règles de grammaire sont fonction du contexte et de la personne à qui l’on s’adresse ?
Le byzantinisme n’est pas loin.
Me Xavier Chabeuf
-
 Par son arrêt du 28 novembre 2018 (17-20.079), la Cour de Cassation adresse un sérieux avertissement aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité consiste à mettre en relation des clients avec des prestataires (chauffeurs, livreurs, coursiers…) qui opèrent pour leur propre compte sous un statut de travailleur indépendant ou d’auto-entrepreneur.
Par son arrêt du 28 novembre 2018 (17-20.079), la Cour de Cassation adresse un sérieux avertissement aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité consiste à mettre en relation des clients avec des prestataires (chauffeurs, livreurs, coursiers…) qui opèrent pour leur propre compte sous un statut de travailleur indépendant ou d’auto-entrepreneur.En l’occurrence, il s’agissait de la société « Take eat easy », qui utilisait (la société a fait faillite entre temps) une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme, et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
Un coursier avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande, au motif qu’elle ne relevait pas du droit du travail.
A tort selon la cour de Cassation, qui commence par rappeler sa jurisprudence quasi-ancestrale selon laquelle « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
Sous ce préambule, l’arrêt énonce : « Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ».
Il faut dire que la Cour d’appel avait relevé que les documents remis au livreur présentaient un système de bonus (le bonus « Time Bank » en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus « KM » lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités (« strikes »), en cas notamment d’absence de réponse à son téléphone, d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison, de cumul de retards sur livraisons, de circulation avec un véhicule à moteur, de circulation sans casque, trois « strikes » en cas d’insulte du « support » ou d’un client, le cumul de deux « strikes » entraînant une perte de bonus, le cumul de trois « strikes » entraîne la convocation du coursier « pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de quatre « strikes » conduisant à la désactivation du compte.
La Cour d’appel avait considéré que ce système, certes évocateur (pour le moins) du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, « ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un « shift » proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait au coursier sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ».
Ce raisonnement n’était pas absurde mais il n’a pas convaincu les hauts magistrats. Pour ces derniers, peu importe la liberté dont pouvait jouir le coursier dans son organisation personnelle ; il était salarié du moment que, lorsqu’il était en opération pour la société Take Eat Easy, il exerçait sa prestation dans le cadre d’un lien de subordination.
Les conséquences d’une telle requalification peuvent être extrêmement lourdes étant donné les demandes qu’elle peut engendrer, tant en ce qui concerne l’exécution passée du contrat de travail ainsi requalifié (rappel de salaire, d’heures supplémentaires, d’avantages conventionnels divers, dommages et intérêts pour violation des durées légales de repos, travail dissimulé, etc…), qu’en ce qui concerne la rupture : la cessation des relations de travail s’analyse en un licenciement abusif avec toutes conséquences de droit.
A bon entendeur …
Me Manuel Dambrin
-
 En droit du travail, lorsque l’activité de l’entreprise est cédée, fusionnée ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent et se poursuivent de plein droit entre le repreneur et le personnel de l’entreprise. La poursuite des contrats de travail s’impose non seulement à l’employeur mais aussi aux salariés, qui peuvent être considérés comme démissionnaires s’ils refusent leur transfert.
En droit du travail, lorsque l’activité de l’entreprise est cédée, fusionnée ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent et se poursuivent de plein droit entre le repreneur et le personnel de l’entreprise. La poursuite des contrats de travail s’impose non seulement à l’employeur mais aussi aux salariés, qui peuvent être considérés comme démissionnaires s’ils refusent leur transfert.Ce mécanisme (prévu par l’article L.1224-1 du Code du travail) connait cependant une exception notable en faveur des journalistes.
En cas de vente ou de changement dans l’actionnariat principal de l’organe de presse qui les emploie, ou simplement du titre auquel ils collaborent, ils ont la faculté de quitter l’entreprise de leur propre initiative et sans motif, en imputant cette rupture à leur employeur, laquelle produit alors les effets d’un licenciement ouvrant droit aux indemnités légales de licenciement (un mois de salaire par année d’ancienneté). Les journalistes pigistes réguliers, quelle que soit leur ancienneté, dont l’entreprise ou le titre est vendu peuvent également bénéficier de cette clause.
C’est la clause de cession prévue par l’article L.7112-5 du Code du travail.
La particularité de cette clause est que son exercice n’est enfermé dans aucun délai : elle s’ouvre avec l’acte de vente mais ne se referme jamais. Le repreneur peut certes indiquer un délai pour que les journalistes prennent position (afin de budgéter le coût des départs, et organiser les éventuelles embauches à opérer) mais celui-ci n’a pas de valeur légale.
Comme le rappelle régulièrement les juridictions, « l'article L. 761-7 (devenu L.7112-5) du Code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en œuvre la clause de conscience ».
La « clause de cession » ne doit pas être confondue avec la « clause de conscience ».
Ces deux clauses produisent à peu près les mêmes effets mais tandis que la clause de cession repose sur un fait objectif en principe facilement vérifiable et n’a pas à être motivée, la clause de conscience fait appel à une appréciation subjective puisque le journaliste devra invoquer, selon l’article L.7112-5 du Code du travail, un « changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ».
L’employeur pourra alors contester le « changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal » pour refuser d’appliquer la clause de conscience.
Me Manuel Dambrin








