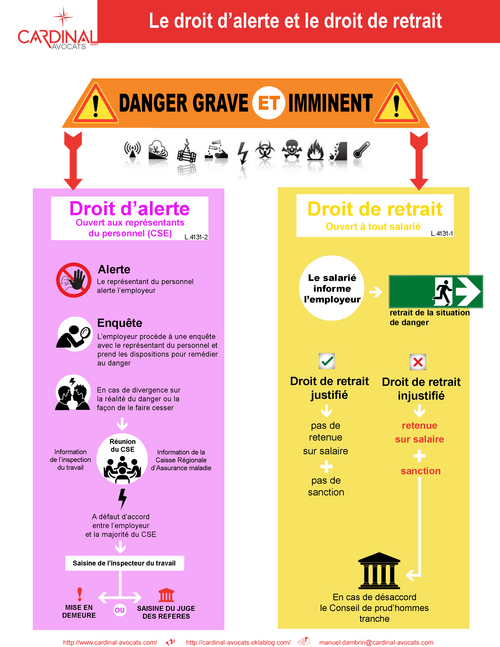-
Par CardinalAvocats le 17 Septembre 2020 à 16:36
 Le principe est bien établi : un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
Le principe est bien établi : un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.Ainsi par exemple, n’est pas justifié le licenciement d’un salarié qui avait dénigré sa supérieure dans un mail adressé à son collègue depuis sa messagerie personnelle, ce qui conférait à ce message un caractère purement privé (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-10.189). De même en est-il ainsi du licenciement d’un directeur de cave licencié pour des agissements frauduleux commis au sein d’une société de négoce de vins, tierce à l’employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030). Même solution pour le vol d’enjoliveurs commis par le salarié sur le véhicule d’un collègue de travail garé à l’extérieur de l’entreprise (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 septembre 2007, 05-45.294). La frontière peut toutefois être ténue entre les faits relevant de la vie professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle.
C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2020 (n° 18-18.317). Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le steward d’une compagnie aérienne avait été licencié pour faute grave ; il lui était reproché d’avoir subtilisé le portefeuille d’un client de l’hôtel où il séjournait durant l’escale en tant que membre d’équipage.
L’intéressé se défendait de toute faute professionnelle en contestant le rattachement des faits reprochés à la vie professionnelle, afin qu’ils échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La Cour de Cassation n’a pas suivi cette argumentation, estimant que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, dans la mesure où ils avaient été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société, laquelle y avait réservé à ses frais des chambres pour son équipage.
Cette solution illustre néanmoins la difficulté à cerner clairement la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Si les faits se déroulant aux temps et lieux de travail n’appellent qu’assez peu de difficulté, il en va différemment lorsqu’ils sont commis en dehors des stricts temps et lieux de travail mais qu’ils conservent un lien avec l’emploi de l’intéressé.
La solution n’allait donc pas de soi.
Il semble que la jurisprudence adopte une position plus stricte avec le salarié lorsque son comportement est de nature à porter atteinte à l’image de l’employeur.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 8 Septembre 2020 à 20:39
 Seul un objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut légitiment justifier des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et permettre d’interdire à un salarié le port d'une barbe arborée comme un signe religieux ou politique.
Seul un objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut légitiment justifier des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et permettre d’interdire à un salarié le port d'une barbe arborée comme un signe religieux ou politique.C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 8 juillet 2020 (n°18-23.743), promis à une large diffusion.
Une société fournissant des prestations de services en matière de sûreté et de défense à des gouvernements et des organisations internationales avait licencié pour faute grave l’un de ses consultants en sûreté dont elle estimait que la barbe était « taillée d'une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politiques », mettant en péril la sécurité d'une mission au Yémen ou dans d'autres zones à risques. L’intéressé contestait son licenciement en estimant qu’il était discriminatoire.
La Cour d’appel de Versailles donnait raison au salarié (CA Versailles 27-9-2018 n° 17/02375), ce qui conduisit l'employeur à se pourvoir en cassation.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle d’abord les principes applicables en matière de respect de la liberté religieuse par l'employeur et des restrictions qu'il peut y apporter.
Elle énonce ainsi que pour être valables, les restrictions à la liberté religieuse doivent 1/ être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ; 2/ répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; et 3/ être proportionnées au but recherché. Elle souligne qu’aux termes de l’article L.1321-3, 2° du Code du travail, de telles restrictions peuvent être prévues par une clause du règlement intérieur à condition de respecter ces principes.
La Cour de Cassation relève ensuite qu’en l’espèce, l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer aux salariés en raison des impératifs de sécurité invoqués.
Pour cette raison déjà, la Cour de Cassation estime que l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisaient l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.
Mais la Cour de Cassation va plus loin ; elle s’interroge sur la possibilité pour l’employeur, en l’absence de règlement intérieur, d'imposer des restrictions à une liberté religieuse. Elle se réfère pour cela à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2017 (CJUE 14-3-2017 aff. 188/15 : RJS 5/17 n° 384) selon laquelle une restriction à la liberté religieuse telle que l'interdiction du port de signe religieux ne peut être justifiée que par une « exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
La Cour de Cassation considère que cette « exigence professionnelle essentielle et déterminante » ne peut couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client ; il faut qu’elle réponde à un objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise.
Elle relève qu’en l’espèce, l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés du salarié.
Elle en déduit que l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite au salarié de revenir à une apparence considérée par l’employeur comme plus neutre caractérisaient bien l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié. Elle confirme donc la décision de la Cour d’appel : le licenciement est nul.
S’il est donc possible pour l'employeur d'imposer une restriction à la liberté religieuse au nom d'un impératif de sécurité, notamment en lien avec le port de la barbe, c’est à la condition qu'il démontre que cette restriction est nécessaire pour prévenir un danger objectif pour l’entreprise ou ses clients.
A titre d’exemple d’un danger objectif, on peut citer l’arrêt de la Cour de Nîmes du 21 juin 2016 (n° 14/04558) qui a déclaré justifié le licenciement d’un salarié travaillant dans une société de démantèlement et de logistique nucléaire dont la barbe empêchait l’étanchéité du masque de sécurité.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 30 Août 2020 à 22:03
Se réjouir à l'idée de partir en vacances en famille, s'apercevoir, à l'aéroport, devant le guichet de la compagnie aérienne, que la pièce d'identité d'un des enfants est périmée et se voir refuser de voyager : scénario catastrophe expérimenté par l'auteur de ces lignes pour un passeport d'enfant expiré depuis... une semaine !
La difficulté tenait au fait que les conditions générales de la compagnie aérienne étaient plus strictes que le droit applicable, en exigeant une pièce d'identité en cours de validité alors qu'une pièce d'identité périmée depuis peu reste utilisable pour franchir les frontières de l'Union européenne.
Mais que faire lorsque les agents de la compagnie aérienne vous refusent l'entrée de l'aéronef, alors que la file des autres passagers s'allonge derrière vous ? On renonce et l'on change ses plans.
Telle ne fut pas la réaction d'une mère de famille qui n'a pas hésité à saisir la justice pour faire reconnaître son bon droit après que, alors que la famille souhaitait partir en vacances en Grèce, l’enfant s’est vu refusé l’accès à l’avion par le transporteur aérien au motif que « son passeport était périmé depuis le mois de mai 2013 », soit depuis 3 ans.
La mère de l’enfant, agissant et son nom et en celui de son enfant, a alors assigné en justice l’agence de voyage et le transporteur aérien et formulé une demande d'indemnisation. Le tribunal d’instance de Paris a débouté la mère de l’enfant de sa demande dans un jugement rendu le 14 février 2018 : le juge a fait application de la directive européenne 2004/38/CE de 2004 qui prévoit que les citoyens de l’Union Européenne ont le droit de séjourner dans un Etat membre moins de 3 mois « sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ».
Ne se décourageant pas, la demanderesse à l’action s'est alors pourvue devant la Cour de cassation, laquelle lui a donné raison par un arrêt rendu par la première chambre civile le 5 février 2020 (n° 18-15.300).
La Cour de cassation a fondé son arrêt sur un accord du 13 décembre 1957 portant sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe qui prévoit que « les ressortissants des parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l’un des documents énumérés à l’annexe audit accord, qui fait partie intégrante de celui-ci ».
Pour la France, les documents mentionnés dans ladite annexe sont la carte national d’identité en cours de validité et le passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans.
En conséquence, il est possible de voyager avec un passeport périme depuis moins de 5 ans et les transporteurs aériens, en théorie, ne sont pas fondés à refuser l’accès à l’avion si un voyageur présente ce type de document.
En pratique, toutefois, la portée de cet arrêt reste circonscrite : cette règle ne s'applique qu'aux 17 Etats du Conseil de l’Europe (sur 47) ayant ratifié l’accord, à la condition expresse que le pays de départ et le pays de destination ont ratifié l’accord.
Il est donc tout de même conseillé de mettre ses documents d’identité à jour avant de partir en voyage dans un des pays de l’Union européenne, sous peine de prendre le risque de rater l’avion.
A défaut, n'hésitez pas à glisser dans vos bagages l'arrêt rendu par la première civile de la Cour de cassation le 5 février 2020 !
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 28 Août 2020 à 09:06
 Tandis que jusqu’à présent le port du masque n’était requis que dans certains secteurs d’activité (commerces et restauration principalement) ou lorsqu’une distance d’un mètre entre le salarié et d’autres personnes ne pouvait être respectée, il devient désormais obligatoire dans toutes les entreprises, à partir du 1er septembre 2020.
Tandis que jusqu’à présent le port du masque n’était requis que dans certains secteurs d’activité (commerces et restauration principalement) ou lorsqu’une distance d’un mètre entre le salarié et d’autres personnes ne pouvait être respectée, il devient désormais obligatoire dans toutes les entreprises, à partir du 1er septembre 2020.Dans tous les espaces clos et partagés au sein des entreprises, notamment les salles de réunion, les open-spaces, les couloirs, les vestiaires, les bureaux partagés, les salariés devront porter le masque. Les bureaux individuels ne seront pas concernés dès lors qu'ils ne sont occupés que par une seule personne.
Les masques devront être fournis par les employeurs puisqu’en effet, selon l’article L.4122-2 du code du travail, "Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs".
Si des masques sont fournis, le refus de les porter pourrait donner lieu à des sanctions de la part de l’employeur notamment sous forme d'avertissement.
En outre, le fait pour un employeur de ne pas fournir de masque ou de laisser ses salariés travailler sans masque pourrait servir de base à une action en reconnaissance d’une faute inexcusable en cas de salariés infectés par le virus.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 10 Août 2020 à 14:39
 Selon l’article L. 1152-1 du Code du Travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L. 1152-1 du Code du Travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».La Cour de cassation vient confirmer que, selon ce texte, l’existence d’un harcèlement moral, en droit du travail, ne nécessite pas de caractériser un élément intentionnel de la part de son auteur, mais seulement de présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, sans que l’employeur soit en mesure de justifier ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cette possibilité que soit reconnue l’existence d’un harcèlement indépendamment de l’intention de son auteur, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu volonté de harceler, doit conduire les employeurs à la plus grande vigilance car cela facilite la reconnaissance des situations de harcèlement notamment lorsque celui-ci résulte d’un environnement de travail ou d’un mode de management.
C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°18-26385).
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, les juges d’appel avaient énoncé que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec la pression, le surmenage, le conflit personnel entre salariés, les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en œuvre de ses fonctions.
Puis les juges ont retenu que le salarié ne démontrait pas que ses objectifs lui avaient été « intentionnellement » fixés de manière inatteignable pour le mettre en défaut par rapport aux années précédentes.
Enfin, pour retenir que l'employeur démontrait que les autres faits matériellement établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les juges ont retenu que le listing des mails reçus par lui ne faisait apparaître que trois mails le dimanche et uniquement 34 adressés le soir après 19 heures ; qu’au surplus le salarié ne démontrait pas qu'il lui était imposé de les consulter immédiatement et d'y répondre avant le lendemain.
Pour la Cour de Cassation, ce raisonnement est erroné : « En statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel qui a, en outre, statué par des motifs impropres à établir, s'agissant de l'envoi des mails au salarié, que l'employeur justifiait ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés ».
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 4 Août 2020 à 14:22
 Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; autrement dit, la charge de la preuve pèse donc sur le demandeur. Selon ce principe, c’est au salarié qu’il incomberait de prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; autrement dit, la charge de la preuve pèse donc sur le demandeur. Selon ce principe, c’est au salarié qu’il incomberait de prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires.Cependant, pour ne pas pénaliser le salarié, souvent démuni lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve de son temps de travail et plus précisément des heures supplémentaires (faute par exemple d’avoir accès aux données du système de pointage), le code du travail déroge à ce principe de droit commun.
L’article L.3171-4 du Code du travail prévoit en effet un régime probatoire particulier, dans lequel la charge de la preuve est partagée entre le salarié et l’employeur. Ce texte énonce :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Puis, en application de ce texte, la jurisprudence a introduit un ordre chronologique dans l’administration de la preuve : c’est d’abord au salarié de soumettre au juge des éléments de nature à étayer sa demande (témoignages, plannings, agendas, e-mails,…) et, si cette obligation est remplie, il appartient alors à l’employeur de contredire ces éléments en justifiant de l’horaire effectivement accompli :
« Il résulte de ces dispositions [L’article L.3171-4 du Code du travail], qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».
Un arrêt inédit de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 2020 (n° 18-26.385) vient confirmer le faible niveau d’exigence attendu du salarié en la matière.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, en effet, le salarié se contentait de verser aux débats « des tableaux de type Word par lesquels il avait récapitulé des heures supplémentaires non vérifiables sans verser d’autres éléments les corroborant ».
La Cour d’appel le déboutait en conséquence de sa demande, relevant au surplus que « travaillant à domicile avant son recadrage, il n’était pas contrôlé dans ses heures de travail et de pause ».
Mais ce raisonnement est censuré. Pour la Cour de Cassation, « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé [L’article L.3171-4 du Code du travail] ».
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 30 Juin 2020 à 16:29
 Durant un arrêt de travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) compense la perte de salaire en versant, sous certaines conditions, des Indemnités Journalières.
Durant un arrêt de travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) compense la perte de salaire en versant, sous certaines conditions, des Indemnités Journalières.Ces conditions sont posées par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment l’obligation « d’observer les prescriptions du praticien » :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail »
Ce texte prévoit en outre les sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions, dont la « restitution à la caisse les indemnités versées » :
« En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 »
C’est ce texte qui a été mobilisé dans le récent arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 2020 (Chambre civile 2, n° 19-15.520).
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, la CPAM avait notifié au salarié un indu ainsi qu’une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée, en l’occurrence une activité sportive (course à pied).
Le salarié avait contesté cette décision en justice et, pour accueillir sa contestation, la Cour d’appel avait retenu que l’entrainement sportif auquel s’était livré le salarié ne constituait pas une activité non autorisée aux motifs, « d’une part, que la victime, pratiquant de longue date [la course à pied], faisait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d’autre part, que les prescriptions portaient l’indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation susceptible d’affecter l’intéressé dans ses droits et prérogatives ». Les juges se fondait également sur une attestation postérieure du médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, qui soulignait, pour les besoins du procès, qu’il avait lui-même incité son patient à poursuivre ses activités sportives, pour suppléer la prise d’anxiolytiques.
Mais ces motifs ne convainquent pas la Cour de Cassation. Pour cette dernière, « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse, le tribunal a violé l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ».
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 29 Juin 2020 à 15:40
 A l’opposé du bien connu « Burn-out » qui peut être défini comme un épuisement lié généralement à un stress intense et/ou une surcharge de travail, le « Bore-out » correspond à une autre forme d’épuisement, provoqué par un manque de travail, l’ennui ou le désœuvrement.
A l’opposé du bien connu « Burn-out » qui peut être défini comme un épuisement lié généralement à un stress intense et/ou une surcharge de travail, le « Bore-out » correspond à une autre forme d’épuisement, provoqué par un manque de travail, l’ennui ou le désœuvrement.Au même titre que le « Burn-out », le « Bore-out » peut caractériser un harcèlement moral ; c’est la leçon à tirer de l’arrêt rendu par la Cour de Paris le 2 juin 2020 (Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, n° 18/05421).
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le salaire occupait un emploi de Responsable des services généraux et, durant une période d’arrêt maladie, il avait été licencié pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, ainsi que le permet la jurisprudence.
Au soutien de la contestation de son licenciement, le salarié faisait principalement valoir qu’il ne s’était plus vu confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, et qu’il avait été affecté à des travaux subalternes. Pour en justifier il produisait, entre autres éléments, des attestations de collègues témoignant de cette situation : « Il me demandait très régulièrement si je n’avais pas du travail à lui confier pour qu’il se sente utile et utilise ses compétences comme on aurait dû les utiliser […] » ; « il s’est dès lors vu retirer ces fonctions de coordinateur et il n’a plus eu la possibilité d’organiser les séminaires des différents départements […] ».
La Cour d’appel a considéré que ces témoignages, dont l’absence de valeur probante ne pouvant être déduit du seul fait que leurs auteurs avaient été en litige avec l’employeur, établissaient « le manque d’activité et l’ennui » dont se plaignait le salarié et que « l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’était pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité ». En outre, pour les juges, le fait que le salarié n’ait jamais contesté sa situation ni oralement ni par écrit avant sa saisine du conseil de prud’hommes ne suffisait pas à établir que les faits qu’il dénonçait, n’étaient pas avérés.
Rappelons en effet qu’en matière de harcèlement moral, le salarié n’a pas à prouver l’existence d’un harcèlement moral mais qu’il doit seulement, selon l’article L. 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aussi bien, considérant que l’employeur échouait à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, la Cour a jugé que le harcèlement était établi.
En conséquence, la Cour a alloué au salarié 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral mais, surtout, elle a annulé le licenciement prononcé, aux termes d’une motivation désormais classique, selon laquelle : « Lorsque l’absence prolongée d’un salarié est la conséquence d’une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu’une telle absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise. Le licenciement est dès lors nul ».
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 11 Juin 2020 à 15:05
 L’employeur ne peut accéder à la correspondance privée d’un salarié, même lorsque celle-ci est hébergée sur le téléphone professionnel qu’il a mis à sa disposition, sans violer le secret des correspondances privées électroniques.
L’employeur ne peut accéder à la correspondance privée d’un salarié, même lorsque celle-ci est hébergée sur le téléphone professionnel qu’il a mis à sa disposition, sans violer le secret des correspondances privées électroniques.C’est l’enseignement de l’arrêt rendu le 24 mars 2020 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (n° 19-82069 D).
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le salarié avait été licencié pour faute lourde puis assigné aux prud’hommes par son ancien employeur pour avoir violé sa clause de non-concurrence. Pour prouver la concurrence, l’employeur avait produit des correspondances issues de la messagerie personnelle que le salarié avait installé sur son téléphone professionnel et qu’il avait oublié d’effacer avant de le rendre (échanges de courriels avec un client et un fournisseur).
Le salarié contre-attaque alors en portant plainte pour atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique.
Il n’est pas suivi par la cour d’appel, qui relaxe l'employeur au motif que le salarié avait omis de paramétrer cette adresse de messagerie comme étant « personnelle » ou « privée », et que le caractère personnel des courriels litigieux ne pouvait se déduire du seul fait qu'ils avaient été échangés à partir d'une adresse mise en place par le salarié. Il faut souligner, en outre, que le règlement intérieur de l’entreprise interdisait l’usage personnel du téléphone professionnel.
Mais ces éléments n’ont pas convaincu la Cour de Cassation.
Celle-ci rappelle l’article 226-15 du code pénal, selon lequel : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
Puis elle ajoute que « la mauvaise foi » prévue par ce texte est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, « quel que soit le mobile auquel il obéit ».
Aussi, pour la Cour de Cassation, « dès lors qu'ils avaient constaté que les messages en cause avaient été échangés entre des tiers et [le salarié] postérieurement au licenciement de celui-ci, depuis son adresse de messagerie personnelle, les juges ne pouvaient déduire de la seule absence d'un paramétrage spécifique indiquant le caractère privé des courriels, que ceux-ci n'étaient pas personnels, sans examiner l'objet des messages utilisés par l'employeur ».
L’affaire devra donc être rejugée par une nouvelle Cour d’appel qui devra examiner le contenu des messages litigieux, pour dire s’il s’agissait de correspondances privées.
Soulignons que la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rappeler que l’employeur ne peut pas se servir de courriels émanant de la messagerie personnelle d'un salarié, distincte de la messagerie professionnelle, comme preuve dans le cadre d’un contentieux qui les oppose. Leur production en justice porterait effectivement atteinte au secret des correspondances, peu important que cette messagerie personnelle soit accessible à partir de l’ordinateur professionnel (cass. soc. 26 janvier 2016, n° 14-15360 ; cass. soc. 23 octobre 2019, n° 17-28448 D).
Me Manuel Dambrin