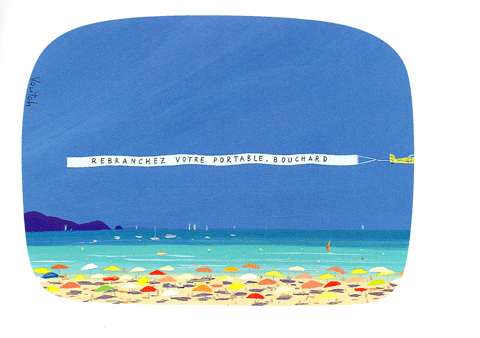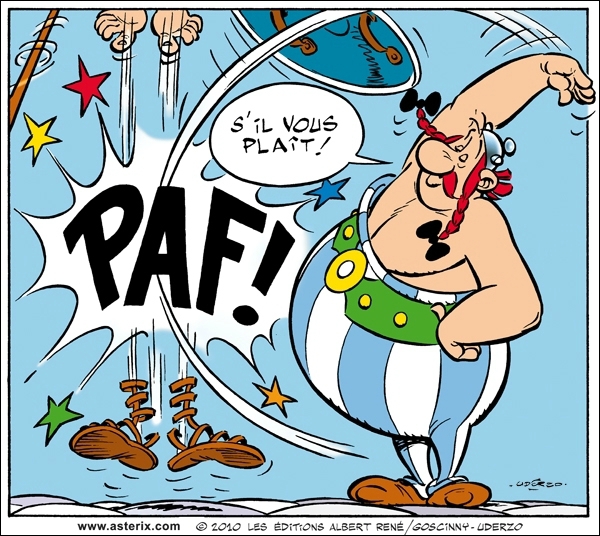-
Par CardinalAvocats le 5 Novembre 2015 à 13:05
Assez peu utilisé en pratique, l’essai professionnel est pourtant un excellent outil d’évaluation durant la phase de recrutement. Il doit être distingué de la période d’essai et est préalable à cette dernière.
Il s’agit, lors d’une opération de recrutement, de tester les aptitudes professionnelles du candidat et le mettant en situation réelle de travail sur le poste à pourvoir pour apprécier ses compétences professionnelles avant toute embauche. Attention toutefois, ce test, pour ne pas être requalifié en relation de travail, doit être limité et intervenir hors conditions normales d’emploi.
Ainsi par exemple, l’employeur peut tester un candidat à un travail manuel en lui faisant réaliser une pièce particulière sur une machine, en lui demandant de rédiger une lettre ou de résoudre un problème.
L’essai professionnel doit être de courte durée (pas plus d’une demi-journée) et suppose une mise en situation « aidée » du candidat, qui ne se trouve pas placé dans des conditions normales d’emploi (cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-41154, BC V n° 4). Il n’a donc pas à réaliser l’ensemble des tâches de l’emploi visé, mais celles essentielles requises pour occuper le poste.
L’essai professionnel ne doit pas être un moyen détourné de faire travailler un candidat avec une prestation de travail effective et productive en le plaçant sous la subordination juridique permanente de l’employeur. Il ne s’agirait pas alors d’un essai mais de travail effectif ouvrant droit à un salaire, voire à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (cass. soc. 26 novembre 2008, n° 07-42673 D).
Aucun texte ne prévoit de rémunération pour l’essai professionnel. Ainsi, une candidate qui effectue un test de quelques heures ne peut pas prétendre avoir exécuté une prestation de travail dans des conditions normales d’emploi et n’a pas à être rémunérée (cass. soc. 16 septembre 2009, n° 07-45485 D).
Il conviendra cependant de se référer à sa convention collective ou aux usages de l’entreprise pour vérifier si une rémunération pour le test est prévue. Si la convention collective ou un usage mentionne un test payant, l’employeur doit rémunérer celui-ci. Si l’essai professionnel est rémunéré, il devra être soumis à cotisations sociales comme tout élément de salaire (cass. soc. 5 novembre 1971, n° 70-12746, Bull. n° 630).
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 23 Septembre 2015 à 17:49
Traditionnellement, il résulte du principe de l’autonomie juridique de la personne morale, déduit de l’article 1842 du Code civil, qu’une société ne peut être condamnée à réparer le préjudice imputé à une autre société du même groupe, cette dernière constituant une personne morale distincte (solution habituelle, cf. Nment : Cass, Com., 24 mai 1982, n°81-11.268).
Ainsi, en théorie, seule la société contractante sera redevable de la dette dont elle est titulaire en cas d’inexécution contractuelle, même si elle fait partie d’un groupe de sociétés.
Cependant, la jurisprudence a depuis longtemps dégagé une exception à ce principe, afin de contourner l’éventuelle insolvabilité d’une société en difficulté appartenant pourtant à un groupe prospère.
Ainsi, lorsqu’une société du groupe s’immisce dans la gestion d’une autre société (notamment au moyen de « décisions de groupe »), elle pourra être condamnée à supporter les conséquences de l’inexécution d’un contrat passé par cette dernière. (Cass, Com., 4 mars 1997, n°95-10.756).
Cette solution s’est par la suite affinée, la Cour de cassation exigeant que cette immixtion ait été de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant (Cass, Com., 12 juin 2012, n°11-16.109).
La Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, sa formation la plus solennelle, a notamment appliqué cette jurisprudence à l’hypothèse spécifique de la société-mère d’un groupe, s’immisçant dans les affaires de l’une de ses filiales. En application de la théorie de l’apparence, la société-mère, laissant croire au créancier qu’elle prenait part à l’engagement de sa filiale, avait été condamnée au paiement de la dette de cette dernière (Cass, Ass. Plén., 9 octobre 2006, n°06-11.056).
Par un arrêt récent du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu plus avant cette jurisprudence (Cass, Com., 3 février 2015, 13-24.895 : Arret).
Dans cette affaire, contrairement aux hypothèses jurisprudentielle précédemment énoncées, la société-mère ne s’était pas ingérée dans les affaires ou la gestion de sa filiale dans le cadre de la négociation ou l’exécution du contrat litigieux.
Toutefois, elle était intervenue auprès du créancier de sa filiale au stade précontentieux, alors que le litige résultant de l’inexécution du contrat était déjà né, et que le créancier s’apprêtait à saisir la juridiction compétente pour obtenir le paiement de sa créance.
La société-mère s’était alors rapprochée du créancier de sa filiale pour discuter le montant de la créance, et tenter d’obtenir un arrangement à l’amiable, proposant la réduction de la créance en appliquant des remises consenties à l’occasion de commandes précédentes.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait condamné la société-mère au paiement de la dette de sa filiale, retenant que l’intervention de la société-mère et sa tentative de négociation du montant de la dette avec le créancier, avaient laissé croire à ce dernier qu’elle se substituait à sa filiale dans l’exécution du contrat.
Dès lors, elle devait répondre de la dette.
Ainsi, désormais, la société-mère, pourra se trouver redevable des dettes de sa filiale, quand bien même elle ne se serait pas immiscée dans les affaires ou la gestion courante de celle-ci (et en particulier dans la négociation ou l’exécution du contrat en cause), dès lors que postérieurement à la survenance du litige, elle a tenté de transiger afin d’en obtenir un règlement à l’amiable.
L’élément clé de cette jurisprudence semble donc être la théorie de l’apparence, la société-mère engageant sa responsabilité à quelque moment qu’elle intervienne auprès du créancier (avant ou après l’émergence du litige) dès l’instant où elle crée dans l’esprit de ce dernier une confusion sur l’identité exacte de son cocontractant.
On ne saurait donc trop conseiller à la société-mère d’un groupe de sociétés, de maintenir une stricte séparation entre sa propre activité et celle de ses filiales, ou, à défaut de prendre soin de ne laisser subsister aucune ambiguïté auprès des créanciers sur l’identité de leur cocontractant, en indiquant clairement que le débiteur reste bien la filiale, à laquelle la société-mère, en dépit de son intervention, n’entend pas se substituer.
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 6 Août 2015 à 18:44
La géolocalisation permet aux entreprises de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des salariés par la localisation des véhicules mis à leur disposition pour l’accomplissement de leur mission.
Le recours et la mise en place de ce procédé doit respecter certaines conditions fixées par la loi et récemment mises à jour par la Commission national informatique et libertés (CNIL : délib. CNIL 2015-165 du 4 juin 2015 => delib).
Conditions de recours
S’agissant d’un moyen de contrôle des salariés, ce dispositif doit respecter le principe de proportionnalité prévu par l’article L.1121-1 du code du travail, selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
L’objectif poursuivi par la mise en place de ce dispositif doit donc préalablement être défini, puis déclaré à la CNIL, qui considère qu’il n’est acceptable que dans les cas suivants :
- le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
- le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;
- la sûreté ou la sécurité du salarié lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;
- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
- le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’employeur, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.
C’est uniquement à titre accessoire que la géolocalisation peut permettre le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des salariés concernés.
Autrement dit, la géolocalisation ne peut dégénérer en filature et les données collectées ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires.
La CNIL impose désormais que les salariés puissent désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules, en particulier à l’issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause, l’employeur pouvant, le cas échéant, demander des explications en cas de désactivations trop fréquentes ou trop longues du dispositif.
Mise en place
Comme cela était déjà le cas auparavant, l’employeur doit informer et consulter les représentants du personnel avant la mise en œuvre de la géolocalisation des salariés.
Il doit ensuite procéder à la déclaration en ligne auprès de la CNIL.
Enfin, les salariés concernés doivent être informés collectivement (affichage) et individuellement (courriers individuels). Le non-respect de cette procédure rend inopposable les informations collectées.
Informations collectées
La CNIL défini aujourd’hui précisément quelles sont les données qui peuvent être traitées, ou pas, par un dispositif de géolocalisation. L’employeur peut collecter et traiter :
- l’identification du salarié (nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule interne, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule) ;
- les données relatives à ses déplacements (données de localisation issues de l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués) ;
- les données complémentaires associées à l’utilisation du véhicule (vitesse de circulation du véhicule, nombre de km parcourus, durées d’utilisation du véhicule, temps de conduite, nombre d’arrêts), sachant toutefois que, sauf si une disposition légale le permet, le traitement de la vitesse maximale ne peut pas s’effectuer ;
- la date et l’heure d’une activation et d’une désactivation du dispositif de géolocalisation pendant le temps de travail.
Enfin, les données ne doivent pas être conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées. La CNIL recommande un délai de conservation de deux ans.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 4 Août 2015 à 15:03
En matière civile, lorsqu’un justiciable envisage de contester la validité d’un acte juridique de droit privé (contrat, donations, etc), celui-ci dispose en principe de deux possibilités.
La première consiste à saisir directement le juge d’une demande tendant à faire annuler l’acte. On parle de nullité par voie d’action.
La seconde, en revanche, n’intervient que lorsqu’une autre personne saisit le juge et fonde sa demande sur ledit acte. La nullité devient alors un moyen de défense, on parle de nullité par voie d’exception.
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité ne peut être introduite, en principe, que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’acte a été passé (sauf les cas particuliers de violence, dol et d’erreur).
Au-delà de ce délai, l’action est considérée comme prescrite, c'est-à-dire que la validité de l’acte n’est plus contestable et celui-ci ne peut donc plus être remis en cause en saisissant le juge.
En revanche, l’article 1304 du Code civil ne s’applique pas à la nullité soulevée en défense, qui selon une jurisprudence bien établie, est perpétuelle. Elle ne se prescrit donc pas (Cass. , Civ. 1ere, 21 décembre 1982, Bull. Civ. I, n°477 ; Cass, Civ. 1ere, 19 décembre 1995, Bull. Civ. I n°371).
Cette règle propre à la procédure civile peut se résumer par l’adage suivant : « ce qui est éphémère par voie d’action est perpétuel par voie d’exception » (« quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum »).
Pour autant, malgré le caractère apparemment établi de cette solution, la Cour de cassation continue à être régulièrement saisie de la question de savoir si la nullité par voie d’exception est perpétuelle ou non.
C’est ainsi que, dans un arrêt du 14 janvier 2015 (arret), la 1ere Chambre civile a eu à se prononcer pour la première fois sur la nullité d’un testament soulevée en défense.
En l’espèce, deux enfants se prévalaient d’un testament lors des opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère tandis que le troisième enfant, lui, contestait la validité de cet acte par voie d’exception.
La Cour d’appel a écarté la contestation de la validité du testament au motif que ce moyen de défense était prescrit depuis plus d’un an.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel et rappelé que l’exception de nullité est perpétuelle et qu’elle déroge en ce sens aux dispositions de l’article 1304 du Code civil.
Conforme à la jurisprudence de la Haute juridiction, cette décision semble logique à première vue, mais, en réalité, celle-ci soulève quelques interrogations propres à la matière successorale, et plus précisément, au testament :
- D’une part, à la différence de l’exception de nullité soulevée à l’égard d’un acte passé par l’une des parties au litige, il s’agit, dans l’arrêt commenté, de contester la légalité d’un testament, qui est un acte unilatéral établi par un tiers, en l’occurrence le défunt, dans tout ce qu’il y a de plus personnel.
Cette remise en cause tardive de la volonté exprimée du défunt, sujette à interprétation et parfois fondée sur des preuves très anciennes, est source de contentieux.
La difficulté de la solution retenue est particulière dans le cas de l’espèce puisque la nullité se fondait sur l’insanité d’esprit de la défunte, autrement dit sur son incapacité physique et mentale à conclure des actes au moment où elle rédigeait ses dernières volontés.
Or la question de la preuve de l’état des facultés d’une personne au moment où un acte a été passé, et dont le décès remonte à plusieurs années, est bien évidemment délicate.
- D’autre part, le principe de la perpétuité de la nullité par voie d’exception a pour conséquence le rallongement des procédures, déjà très longues en matière successorale, et met les héritiers avantagés par un testament à la merci de l’hériter « défavorisé ».
En effet, pendant les cinq premières années, cet héritier peut engager une action directe en nullité du testament, laquelle peut ensuite être soulevée perpétuellement par le seul héritier défavorisé, qui occupe la position de défendeur à l’action.
Ainsi, l’héritier « défavorisé » est particulièrement bien loti pour nuire à leurs intérêts et bloquer la liquidation de la succession.
Cette solution, certes conforme au droit, n’est pas de bonne politique : une fois un testament connu et porté à la connaissance de tous les héritiers, un délai de cinq années apparaît largement suffisant pour que chacun fasse état de ses doutes quant à sa validité et émette les contestations qui lui semblent utiles.
Passé ce délai, la prescription devrait reprendre ses droits, et la liquidation de la succession intervenir sans que l’argument de la nullité éventuelle du testament puisse être soulevée ad vitam aeternam.
Telle n’est cependant pas la solution applicable, malheureusement.
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 27 Juillet 2015 à 20:06
Nous abordions déjà la question du taux d'intérêt légal dans un article précédent, ainsi que son nouveau mode de calcul (cf. notre post du 7 janvier 2015).
Un arrêté du 24 juin 2015 précise que pour le second semestre 2015, le taux de l'intérêt légal est fixé :
"1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,29 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,99 %."Soit une augmentation de 0,23 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et de 0,06 % pour les autres.
Il faudrait encore que les taux augmentent un peu pour que les payeurs récalcitrants trouvent un intérêt pressant à s'acquitter de leurs dettes.
-
Par CardinalAvocats le 26 Juin 2015 à 19:58
Un salarié licencié pour motif économique à la suite de l’entrée de son employeur en procédure collective peut-il demander réparation de son préjudice à un tiers dont le comportement fautif est responsable de la déconfiture de l’entreprise ?
Cette question, à la croisée du droit des entreprises en difficulté et du droit du travail, n’est pas sans conséquence pour les salariés licenciés, puisqu’une réponse affirmative leur permettrait d’obtenir une indemnisation au-delà de la seule procédure prud’homale directement intentée contre l’ancien employeur, et donc, in fine, plus importante.
Une réponse opportune est apportée par l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 2 juin 2015, qui se place en faveur d’une telle indemnisation pour le salarié (Cass, Com., 2 juin 2015, n° 13-24.714).
En l’espèce, à la suite d’un montage financier frauduleux mis en place par une banque pour lui octroyer des crédits ruineux, une société est placée en redressement judiciaire et un plan de cession partielle prévoyant le licenciement de 600 salariés est arrêté.
Parallèlement, le commissaire à l’exécution du plan assigne la banque fautive en responsabilité civile pour octroi des crédits ruineux. Cent-neuf des salariés licenciés décident alors d’intervenir volontairement à la procédure afin d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, à savoir la perte pour l’avenir des rémunérations qu’ils auraient pu percevoir, et l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d’avoir pu bénéficier d’une formation qualifiante.
La Cour d’appel déclare cette intervention volontaire irrecevable au motif que les préjudices subis par les salariés sont inhérents à la procédure collective (puisqu’ils en sont la conséquence directe) et qu’ils sont subis indistinctement et collectivement par l’ensemble des créanciers. Dès lors, la réparation de ces préjudices relèverait du monopole du commissaire à l’exécution du plan.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas de cet avis, et juge que « l’action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait pas du monopole du commissaire à l’exécution du plan ». Ainsi, les salariés étaient fondés à demander la réparation de leur préjudice devant les juridictions ordinaires, hors du cadre de la procédure collective.
Par ailleurs, elle ajoute que le fait que leur préjudice ait déjà été réparé par l’allocation d’indemnités de rupture à l’occasion d’une action prud’homale antérieure, ne rend pas irrecevable la demande de réparation du second préjudice, laquelle pourrait, a priori, être examinée.
Ainsi, bien qu’elle ne statue naturellement pas sur le bien-fondé de la demande indemnitaire des salariés licenciés (la Cour de cassation étant juge du droit, il ne lui appartient pas de déterminer si, en l’espèce, la banque est effectivement responsable de leur préjudice), elle affirme clairement la recevabilité procédurale de principe d’une telle action (ce qui ne préjuge toutefois pas de son issue).
Deux conséquences principales sont à noter : d’abord, l’extension considérable du champ de l’action en responsabilité intentée par le salarié licencié pour motif économique, qui peut désormais agir en dehors des limites de la procédure prud’homale s’il estime que son licenciement a pu être causé, même de manière indirecte ou diffuse, par un tiers qui aurait crée par son comportement la situation rendant nécessaire le licenciement économique.
Ensuite (et c’est le corollaire de la première conséquence) l’augmentation des perspectives indemnitaires du salarié, qui peut maintenant, si les circonstances le permettent, former plusieurs actions simultanément devant plusieurs juridictions différentes (prud’homales d’une part et de droit commun d’autre part), et donc, si celles-ci aboutissent, obtenir une meilleure réparation.
Me Manuel Dambrin et Monsieur Hugo Tanguy, élève avocat.
-
Par CardinalAvocats le 10 Mai 2015 à 22:58
Par souci de protection du salarié, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation n’hésite pas à accroitre sa sévérité face à des hypothèses de harcèlement au travail.
L’arrêt récent rendu le 11 mars 2015 en est un bon exemple (Cass, Soc, 11 mars 2015, n°13-18.603).
En l’espèce, une salariée, victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique direct, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le Conseil de prud’hommes. Devant cette juridiction, elle arguait d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur, qui ne contestait pas la réalité des faits de harcèlement sexuel et moral commis par son préposé, tentait d’écarter sa propre responsabilité en indiquant qu’il n’avait eu connaissance de ces faits qu’avec la dénonciation qui lui en avait été faite, et qu’il avait aussitôt pris les mesures appropriées et sanctionné l’auteur en prononçant son licenciement pour faute grave. Dès lors, il aurait pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu’il n’aurait pas manqué à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation choisit de casser l’arrêt d’appel qui avait donné raison à l’employeur, retenant que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ».
Cette solution repose sur la distinction fondamentale entre une obligation de sécurité de moyens et une obligation de sécurité de résultat.
Une obligation de sécurité de moyens n’impose pas à l’employeur d’obtenir effectivement la sécurité de ses salariés, mais simplement de prendre toutes les mesures propres à éviter la survenance d’un risque. Si ce risque survient malgré tout, l’employeur ne sera pas civilement responsable si toutes les mesures de prévention avaient été prises.
Au contraire, une obligation de sécurité de résultat impose à l’employeur d’assurer la sécurité effective de ses salariés, un manquement étant constitué dès lors qu’un risque se réalise, quand bien même il aurait pris toutes les mesures possibles permettant de l’éviter.
Sans surprise, l’arrêt commenté prend position en faveur de la seconde option, et retient qu’en matière de sécurité des travailleurs, l’employeur est soumis à une obligation de résultat.
Dans un second temps, la haute juridiction conclut son arrêt en affirmant « qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que la salariée avait été victime d’un harcèlement moral et sexuel dans l’entreprise, la Cour d’appel à laquelle il appartenait dès lors d’apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés [imposant à l’employeur une obligation de sécurité] ».
Elle rappelle donc clairement que le seul critère permettant de déterminer si une prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée ou non reste donc celui de la gravité du manquement rendant impossible la poursuite de ce contrat, peu importe le comportement de l’employeur.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 25 Avril 2015 à 20:23
Un nouveau décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différents vient poser de nouvelles obligations préalables à l'introduction d'une action judiciaire.
il est désormais prévu que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, l'assignation ou la requête qui saisit la juridiction de première instance devra préciser les diligences entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance, des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Quelques observations à ce sujet :
- La pratique avait depuis bien longtemps intégré l'utilité de se rapprocher de la partie adverse avant d'engager une procédure contentieuse. Il s'agit là de simple bon sens, ce ce d'autant que nul l'ignore l'incertitude, la longueur, le coût d'une procédure judiciaire.
- La loi avait déjà rendu obligatoire cette nécessité d'une tentative de résolution apaisée du litige, dans un certain nombre de matières, comme par exemple en matière de liquidation de l'indivision successorale ou du régime matrimonial. L'obligation d'engager une discussion et de tenter de parvenir à un règlement non contentieux du différend est aussi bien souvent prévue dans les contrats commerciaux. Le nouveau décret ne fait donc que systématiser et de rendre impératif ce qui existait déjà lorsque la nécessité ou la volonté des parties l'imposait.
- Pourquoi alors rigidifier dans un décret assorti d'exceptions qui créent de l'incertitude juridique ce que la pratique avait depuis longtemps (toujours ?) mis en place ? Pourquoi limiter le pouvoir d'appréciation du juge en lui imposant de juger conformément à de nouvelles contraintes ? Ne savait-il pas, jusqu'à présent, distinguer entre les démarches contentieuses qui, se dispensant du préalable d'un échange honnête et de bonne foi, laissaient apparaître le demandeur pour ce qu'il était, un mauvais querelleur ? N'était-il pas également conscient du fait que, dans certaines circonstances, il est vain de se perdre en discussions de salon car le différend existe et doit être tranché ? Le gouvernement, par ce nouveau décret, restreint encore la liberté d'appréciation des magistrats, d'action des parties et des avocats, dans l'espoir de bâtir un monde qui repose sur des bases erronées.
- Ces bases erronées, c'est la volonté de construire un monde sans conflit, dans lequel, par les vertus du dialogue et de l'échange apaisé, il serait possible de parvenir à l'harmonie universelle, et comme le proclame la vulgate gouvernementale, de "faire société".
- La réalité, est que la société française, comme toute société, est traversée de conflits, culturels ou d'intérêts. L'appareil judiciaire d'Etat a précisément été mis en place pour trancher ces différends et pour éviter le règne de l'anarchie et de la force brute. Ce pouvoir régalien est la justification même de son existence. L'Etat ne doit pas démissionner devant son devoir : il doit dire le droit et trancher les différends, chaque partie ayant été assistée d'un avocat afin que ses droits soient au mieux défendus et respectés.
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 8 Avril 2015 à 23:10
Sur le blog consacré à la consommation de Rafaële Rivais :
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2015/04/02/faut-il-se-mefier-de-skymediator/
Article de la même Rafaële Rivais dans la version "papier" du quotidien en date du 10 avril 2015 : Vol_en_retard
-
Par CardinalAvocats le 7 Avril 2015 à 12:43
La réparation des préjudices liés aux conditions de travail n’en finit pas de s’accroître.
En effet, la jurisprudence, consciente des problématiques actuelles de souffrance au travail, et soucieuse de protéger toujours mieux le salarié contre les violations par l’employeur de ses obligations contractuelles, interprète de manière toujours plus extensive les dispositions du Code du travail.
C’est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent rendu le 3 mars 2015 (Cass. Soc., 3 mars 2015, n°13-23.521), indique de manière très claire le caractère cumulatif des indemnisations respectives de plusieurs préjudices résultant des conditions de travail du salarié, tels que la discrimination et le harcèlement moral.
En l’espèce, une salariée, à la suite de plusieurs congés maternité successifs, avait vu son activité professionnelle graduellement diminuée, entraînant pour elle une diminution de sa rémunération, dont une part importante était variable, et lui occasionnant un sentiment vexatoire d’être « mise au placard ».
Elle avait alors saisi les juridictions du travail, demandant, notamment, la réparation des préjudices matériels et moraux résultant, d’une part, d’une discrimination fondée sur son état de grossesse, et d’autre part, des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime.
La Cour d’appel de Paris, après avoir retenu l’existence en l’espèce d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse de la salariée et alloué à celle-ci une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, rejette la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral, retenant que « les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis à la cour de retenir l’existence d’une discrimination et que le préjudice est également identique dès lors que les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral qui a effectivement été subi. »
Ainsi, pour la juridiction du second degré, la discrimination et le harcèlement moral s’excluraient mutuellement, dès lors que les faits qui en sont l’origine et les préjudices qui en résultent sont identiques dans les deux hypothèses.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et casse l’arrêt d’appel, jugeant que « les obligations résultant des articles L. 1132-1 [prohibant la discrimination] et L. 1152-1 [prohibant le harcèlement moral] du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. »
Pour la haute juridiction, les préjudices causés par les faits de discrimination (« résultant de la privation d’une partie des fonctions de l’intéressée après retour de ses congés maternité ») et par ceux de harcèlement moral (« résultant de l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée ») sont distincts et en tant que tel, appellent deux indemnisations distinctes.
La Cour de cassation se place ici très clairement en faveur du salarié, n’hésitant pas à démultiplier les préjudices pour permettre une meilleure indemnisation de ce dernier.
Ma Manuel Dambrin et Monsieur Hugo Tanguy (élève avocat)
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique