-
Par CardinalAvocats le 20 Novembre 2017 à 21:02
 Alors qu’il attendait son tour dans la salle d’attente du médecin du travail, pour une visite périodique, le salarié fait un malaise et décède.
Alors qu’il attendait son tour dans la salle d’attente du médecin du travail, pour une visite périodique, le salarié fait un malaise et décède.L’accident est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne en tant qu’accident du travail, ce que conteste l’employeur.
Ce dernier fait valoir en effet que le malaise dont a été victime son salarié s’est produit un jeudi, en dehors de ses jours de travail et à l’extérieur de l’entreprise et que, de surcroit, le malaise est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n’effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, de sorte que la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas rapportée.
L’employeur se référait ainsi à la définition de l’accident du travail donné par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale qui énonce qu’un accident du travail est un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » et précisée par la Cour de cassation qui énonce qu’un accident du travail est « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Se référant à la lettre du texte, la Cour d’appel a fait droit au recours de l’employeur et lui a déclaré l’accident inopposable en considération de l’absence de preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Par une décision du 6 juillet 2017 (n°16-20.119), considérant sans doute que les examens périodiques auprès du médecin du travail sont inhérents à l’exécution du contrat de travail, elle juge que le salarié devait bénéficier de la qualification d’accident du travail.
Me Manuel DAMBRIN
-
Par CardinalAvocats le 3 Novembre 2017 à 13:22
Le second arrêt concerne le cas de Maurice Jarre, né en 1924 à Lyon et décédé à Malibu (Californie, Etats-Unis) en 2009.
Il est l’un des plus grands compositeurs de musique de films du XXème siècle, multi oscarisé, l’un des rares Français à disposer de son étoile au Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. On lui doit notamment les musiques de Lawrence d'Arabie (1962), Le Docteur Jivago (1965), Paris brûle-t-il ? (1966), Les Damnés (1969), Soleil rouge (1971), Witness (1985), Gorilles dans la brume (1988), Le Cercle des poètes disparus (1989), Ghost (1990).
Marié quatre fois, père de trois enfants issus de ses trois premières épouses (un chacun, dont le compositeur Jean-Michel Jarre, en 1948, avec sa première femme), Maurice Jarre s’est marié en 1984 avec la femme qui lui survivra.
Utilisant le même procédé que Michel Colombier, Maurice Jarre a constitué avec son épouse, en 1991, un family trust de droit californien auquel ont été transférés tous les biens de Maurice Jarre, dont, notamment, une société civile immobilière française détenant un bien immobilier parisien.
Il a également établi un testament léguant tous ses biens meubles (donc l’intégralité des droits sur ses compositions musicales) à sa veuve, le solde étant attribué au family trust dont la veuve était l’unique bénéficiaire.
Les trois enfants issus de précédentes unions étaient déshérités.
Ils ont contesté cette situation, sur un autre fondement juridique que dans le cas de Michel Colombier, afin de se voir attribuer leur part sur les biens situés en France.
Ils soutenaient cependant pareillement que « la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel de droit français relevant de l’ordre public international ».
Ils demandaient en conséquence que la loi californienne ne connaissant pas le principe de la réserve héréditaire soit écartée au profit du droit français.
Pareillement la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198) s’est prononcée par des motifs identiques à ceux figurant dans l’arrêt concernant Michel Colombier (cf. supra).
Que retenir de ces deux arrêts de principe ?
1 – La réserve héréditaire n’est pas un principe essentiel de droit français relevant de l’ordre public international.
2 – Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire peut être appliquée à la succession d’un Français, libre, dans ces conditions, de déshériter ses enfants ou seulement certains d’entre eux.
3. Une seule réserve à cette liberté est préservée, lorsque les héritiers écartés se trouvent dans « une situation de précarité économique ou de besoin », ce qui n’était pas le cas dans les deux affaires examinées ci-dessus.
Mais cette limite suscite elle-même des interrogations : quel est l’état de besoin ou de précarité économique dont il faut faire état pour faire échec à la loi étrangère ignorant la réserve héréditaire ? Dans quelle mesure la loi étrangère est-elle écartée ?
Surtout, pratiquement, l’on peut se demander si un héritier connaissant de véritables difficultés économiques aura la capacité de soutenir une action judiciaire susceptible de durer de nombreuses années, et l’on peut aussi s’interroger sur la capacité que ce dernier aura à faire appliquer la décision française à l’étranger alors que le partage de la succession sera intervenu, conformément à la loi étrangère, depuis des années.
La limite posée par la Cour de cassation pour préserver les apparences d’une sauvegarde de la réserve héréditaire est bien théorique : la réserve héréditaire peut être écartée par l’application d’une loi étrangère ne la connaissant pas.
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 2 Novembre 2017 à 23:22
Le décès de deux grands compositeurs de musique français, tous deux établis de longue date en Californie, a donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation concernant la possibilité de contourner le principe de la réserve héréditaire prévu par le droit civil français en faisant application du droit californien des successions.
Ils ont été rendus le même jour, le 27 septembre 2017.
*
Rappelons, tout d’abord, que le code civil définit la réserve héréditaire comme étant la part de la succession réservée aux héritiers dits réservataires (conjoint, descendants) selon des modalités prévues aux articles 912 à 917 du code civil.
En présence d’héritiers réservataires, le défunt ne peut disposer librement que de la quotité disponible (dont la proportion varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires).
On considère qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire lorsque les libéralités faites par le défunt excèdent le montant de la quotité disponible.
Les héritiers réservataires sont alors en droit de demander que la part des donations et legs ayant dépassé le montant de la quotité disponible leur soit restituée : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent » (article 924 du code civil).
La réserve héréditaire, qui interdit au défunt de déshériter de ses enfants ou seulement une partie d’entre eux, constitue l’un des piliers du droit français des successions, présent depuis son origine dans le code civil, et censé garantir la cohésion familiale et le principe d’égalité entre les héritiers.
Autant dire que dans une conception de la famille dynamitée par la révolution des mœurs depuis une cinquantaine d’années, ce principe est contesté par certains et que les tentatives de contournement des résidents français sont légion.
Mais ce principe est aussi menacé par l’application des règles de conflit de droit privé, c’est-à-dire les règles décidant de l’application de la loi de tel ou tel pays à des citoyens ayant organisé leur vie et la répartition de leurs intérêts patrimoniaux dans différents pays.
En effet, la réserve héréditaire, principe de droit français, est méconnu par nombre de nos voisins européens ainsi que par la plupart des pays étrangers.
Si, en proportion, les cas nombreux concernent des Français résidant dans d’autres pays de l’Union européenne où la réserve héréditaire n’existe pas (Espagne, par exemple), le cas qui nous intéresse ici est la Californie, sachant que le droit des successions n’est pas, aux Etats-Unis, une compétence de l’état fédéral mais de chacun des cinquante états fédérés.
Le premier arrêt concerne le compositeur Michel Colombier, compositeur de centaines de musique de films et de séries télévisées tant en France qu’aux Etats-Unis, né à Lyon en 1939 et décédé à Santa Monica (Californie, Etats-Unis), en 2004.
Après une riche carrière française (L’Alpagueur, Le Pacha, L’arme à gauche, L’héritier, Un flic, …), Michel Colombier s’était établi aux Etats-Unis à la fin des années 1970 pour travailler pour Hollywood.
Marié plusieurs fois, Michel Colombier laissait à son décès quatre enfants issus de précédentes unions, une veuve, qu’il avait épousée en 1990, et deux filles issues de sa dernière union.
En 1999, il a établi et fait enregistrer aux Etats-Unis un testament aux termes duquel il léguait tous ses biens à un family trust. Il était aussi prévu que l’époux survivant deviendrait l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, lesquels devaient ensuite revenir aux deux filles issues de la dernière union.
Les quatre enfants issus de précédentes unions étaient déshérités.
Lorsque Michel Colombier est décédé, en 2004, sa veuve est devenue la seule bénéficiaire, par l’intermédiaire du family trust, de la succession comprenant des immeubles aux Etats-Unis, des biens mobiliers aux Etats-Unis et en France et notamment toutes les redevances et droits attachés à ses compositions musicales.
Trois des enfants déshérités ont alors saisi le Tribunal de grande instance, soutenant en substance que l’ordre public international français s’opposait à la loi californienne qui ignore la réserve héréditaire et demandant que leurs droits d’héritiers réservataires devaient être respectés.
En gros, ils réclamaient leur part de l’héritage en indiquant que si le droit californien s’appliquait en principe à la succession de leur père (résidence aux Etats-Unis les trente dernières années de sa vie, naissance dans ce pays de ses deux derniers enfants, localisation aux Etats-Unis de tout son patrimoine immobilier et de l’essentiel de son patrimoine mobilier), il devait être écarté au profit du droit français car il ignorait le principe essentiel du droit français, relevant de la conception française de l’ordre public international, tenant au respect de la réserve héréditaire.
Cette argumentation est écartée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié à son Bulletin (Cass. 1ère civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151) : « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
La seconde partie dans un article à paraître prochainement...
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 20 Octobre 2017 à 15:14
 En raison du coût que peut représenter les heures supplémentaires il est parfois tentant pour l’employeur de déroger à la durée légale du travail (35 heures) en recourant au « forfait jour », c’est-à-dire en décomptant le temps de travail en jours et en payant un salaire forfaitaire fixe, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
En raison du coût que peut représenter les heures supplémentaires il est parfois tentant pour l’employeur de déroger à la durée légale du travail (35 heures) en recourant au « forfait jour », c’est-à-dire en décomptant le temps de travail en jours et en payant un salaire forfaitaire fixe, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
Rappelons que cette modalité de décompte du temps de travail peut concerner non seulement les cadres qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, mais aussi les non-cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions. Ces derniers doivent toutefois bénéficier, eux-aussi, d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.
Mais le recours au « forfait jour » n’est pas forcément la panacée et peut très vite se retourner contre l’employeur s’il n’est pas utilisé dans les règles édictées par la jurisprudence et récemment codifiées par la loi n° 2016-1088, dite « loi Travail », du 8 août 2016.
La sanction ne pardonne pas car si les conditions du recours au « forfait jour » ne sont pas remplies, celui-ci peut être annulé ou déclaré inopposable au salarié, qui aura alors le champ libre pour solliciter le règlement d’heures supplémentaires majorées pour le temps de travail accompli au-delà de l’horaire légal (35 heures).
Il faut évidemment que le « forfait jour » soit inscrit dans le contrat de travail mais cela ne suffit pas.
Il faut surtout, et avant toutes choses, que la possibilité de recourir à une convention de forfait en jours soit prévue par un accord collectif et que cet accord collectif contiennent des stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, au sens des dispositions européennes et constitutionnelles.La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de censurer bon nombre de dispositions conventionnelles – dont certaines ont, depuis, été réécrites par les partenaires sociaux – qui ne garantissaient pas suffisamment le respect effectif de durées raisonnables de travail ainsi que des repos suffisants (Industrie Chimique, Commerce de gros, SYNTEC, …).
Le récent arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 oct. 2017 (n° 16-23.106) illustre cette exigence et la renforce. Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, l’accord collectif prévoyait les garanties suivantes :
-La saisine hebdomadaire par le salarié de son temps de travail dans le système de gestion des temps ;
-L’établissement chaque mois d’un état récapitulatif du temps travaillé par personne pour le mois M-2 et le remise de cet état à la hiérarchie ;
-Une présentation de ces données chaque année au comité de suivi de cet accord ;
-L’assurance que le repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives ;
-Le bénéfice d’un moins une journée de repos par semaine.
La Cour Suprême juge que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, faute de « prévoir un suivi effectif par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».
Elle déclare en conséquence que les dispositions du forfait jour sont inopposables au salarié.
En pratique, il convient d’organiser un dispositif de contrôle par l’employeur, qui soit assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec une possibilité de demande d’entretien.
Cette exigence est d’ailleurs consacrée par la loi dite « loi Travail », du 8 août 2016, qui prévoit que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (art. L. 3121-60 du code du travail) et que l’accord collectif doit comporter « les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié » ainsi que « les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié » (art. L. 3121-64, II du code du travail).
Me Manuel DAMBRIN
-
Par CardinalAvocats le 17 Octobre 2017 à 10:35

Dans un récent arrêt du 5 septembre 2017 la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat Roumain dont les juridictions avaient approuvé le licenciement d’un salarié qui avait été licencié pour avoir utilisé internet au bureau à des fins personnelles en échangeant des messages personnels par le biais de Yahoo Messenger.
C’est l’occasion de rappeler les conditions dans lesquelles l’employeur peut surveiller l’émission ou la réception par le salarié d’e-mails personnels, à partir de l’ordinateur professionnel.
Le principe : les mails personnels adressés et reçus par le salarié sur l’ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, ce qui implique qu’ils sont à la disposition de l’employeur, qui peut les lire, même en dehors de la présence du collaborateur, et y trouver éventuellement un motif de sanction.
L’exception au principe : si ces e-mails sont clairement identifiés par le salarié comme « personnel » (concrètement cette mention « personnelle » sera indiquée dans la barre « objet » ou au début du message), alors ils sont réputés relever de la vie privée du salarié et l’employeur ne pourra pas les exploiter puisque, depuis l’arrêt Nikon du du 2 octobre 2001 (n°99-42.942), « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».
De façon plus générale, l’employeur ne peut ouvrir les messages, dossiers ou fichiers identifiés dans leur titre comme « personnel », contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en ayant précédemment avisé le salarié (Cass. Soc. 17 juin 2009, n° 08-40.274).
La question se pose aussi de savoir quel est le sort des e-mails échangés depuis le lieu – et l’ordinateur – de travail mais avec une messagerie personnelle : ces échanges sont protégés par le secret des correspondances. La Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 janvier 2016 selon lequel « Mais attendu qu'ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances ».
Me Manuel DAMBRIN
-
Par CardinalAvocats le 16 Octobre 2017 à 14:16

La loi instaure une protection particulière dans l’intérêt des salariés victimes de harcèlement moral, de ceux qui témoignent de tels faits ou les dénoncent : toute mesure prise à l’encontre de ces salariés est nulle et ouvre droit pour le salarié à réparation (ou à réintégration dans l’entreprise en cas de licenciement).
L’arrêt rendu le 13 septembre 2017 (n° 15-23.045) par la Cour de Cassation vient limiter le bénéfice de cette protection exceptionnelle en posant que pour en bénéficier, le salarié doit avoir expressément qualifié de « harcèlement moral » les faits qu’il dénonce.
Dans cette affaire, le salarié avait adressé un mail à son employeur afin de lui faire part « du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste » qu’il estimait subir mais il n’avait pas employé la terminologie de « harcèlement moral ». Il fût licencié consécutivement à ce mail, au motif qu’il avait créé l’illusion d’une brimade et proféré des accusations diffamatoires constitutives d’un abus de sa liberté d’expression.
Considérant avoir été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, le salarié contestait son licenciement et obtenait gain de cause, jusque devant la Cour d’appel. Les juges considéraient en effet que dans son mail le salarié avait visé des agissements de harcèlement moral même si ces termes n’avaient pas été expressément employés.
Mais la Cour de Cassation censure cette décision : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ».
Cette solution surprend car en vertu de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». La Cour d’appel pouvait donc analyser les termes du mail litigieux comme décrivant une situation de harcèlement moral.
L’avenir dira si cette position est étendue au harcèlement sexuel.
Me Manuel DAMBRIN
-
Par CardinalAvocats le 2 Octobre 2017 à 15:07
La fièvre de l’entrepreneur qui crée son entreprise est parfois si vive que les quelques semaines à attendre avant qu’elle ne soit immatriculée lui paraissent une éternité.
Il est aussi fréquemment des situations dans lesquelles la société n’est pas encore officiellement créée et où ses dirigeants ont déjà noué des contacts avec lesquels ils risqueraient de ne pas conclure en laissant passer des opportunités considérées comme unique. Il est parfois urgent de signer un bail, de signer une promesse d’achat, de lancer un processus de production, …
Cet entrepreneur, l’avocat l’enjoint à la plus grande prudence, sur la base des règles de droits opportunément rappelées, de manière synthétique, par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 6 juillet 2017 (n° 16/02902).
Selon l’article 1842 du Code civil, les sociétés « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». L’immatriculation de la société est son acte de naissance. Avant, elle n’existe juridiquement pas (sauf pour ses associés liés par le contrat de société) et ne peut pas être créancière ou débitrice de droits.
La Cour rappelle que les actes conclus par une telle société sont nuls de nullité absolue et qu’il « en résulte que le cocontractant peut se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et celles-ci n’étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société ».
La seule manière pour une société en cours de formation de conclure des engagements valables est, cumulativement :
- Que la ou les personnes qui agissent, non seulement aient entendu le faire pour le compte de la future société, mais encore qu’elles l’aient formellement précisé, les tiers devant être informés de la situation juridique de la société. A cet égard, il est essentiel que la mention « société en formation » ou « pour le compte de la société en formation » figurent expressément sur tous les actes souscrits pour le compte de la future société. Il doit être possible d’identifier ladite société en formation avec suffisamment de précision (siège social, dirigeant, dénomination sociale) ;
- Que les actes soient repris par la société une fois immatriculée, les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. Cette reprise prend généralement la forme d’une annexe aux statuts listant avec précision chacun des actes accomplis pour le compte de la société au cours de la période de sa formation, annexe devant être soumise à l’approbation des futurs associés qui sont libres de reprendre, ou non, les actes accomplis par l’un d’entre eux pendant la période de formation.
Que se passe-t-il si ces prescriptions ne sont pas respectées ?
Les conséquences sont lourdes car l’article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis».
Ainsi, la société n’existant pas, les contrats conclus au nom de cette dernière sont nuls, et ceux qui se sont engagés en son nom sont individuellement responsables, sans qu’il y ait à ce stade de distinction entre la personne morale de la société (elle n’existe pas) et la personne physique de ses dirigeants.
Me Xavier Chabeuf
-
Par CardinalAvocats le 25 Septembre 2017 à 21:39
L’une des innovations de la réforme du droit du travail consiste à assouplir le formalisme attaché à la rédaction de la lettre de licenciement.
Jusqu’à présent, selon la formule consacrée, la lettre de licenciement « fixait les termes du litige » ce qui voulait dire qu’elle devait indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifiaient la rupture, et ce de façon définitive. Si l'employeur omettait de mentionner les raisons de la rupture ou que la lettre n’était pas suffisamment motivée, il n'avait plus aucun moyen de se défendre lors d'un éventuel procès : ce « vice de forme » rendait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, automatique, quand bien même les raisons du licenciement étaient valables.
Contrairement à certaines interprétations hâtives, l’obligation de motiver la lettre de licenciement demeure. Ce sont les conséquences du défaut ou de l’insuffisance de motivation qui changent.

Désormais, selon le nouvel article L.1235-2 du code du travail, « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés ou complétés, soit par l’employeur, soit à la demande du salarié ».
Le texte ajoute que « à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier [demande de précision des motifs], l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ».
Autrement dit, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement n’ouvre plus droit qu’à une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité de procédure et ne permet plus d’invalider le licenciement sans examen des motifs invoqués au soutien dudit licenciement même si ces derniers n’ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement.
Me Manuel Dambrin
-
Par CardinalAvocats le 19 Septembre 2017 à 21:14
C’est l’enseignement que l’on peut tirer d’une décision de la Cour d’appel de Paris statuant dans un litige qui opposait un chef de rang à son employeur. S’estimant harcelé moralement, ce dernier avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et tentait de démontrer que son départ ayant été consécutif aux agissements de harcèlement de son employeur, il devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud'hommes adhérait à cette thèse et allouait de surcroît au salarié 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.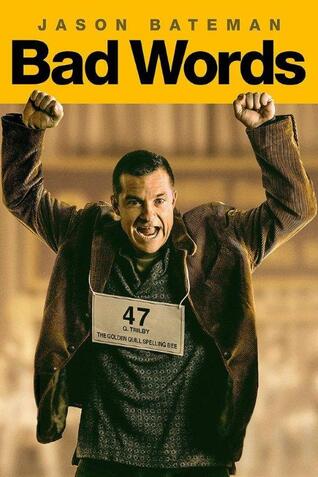
Mais la Cour d’appel infirmait ce jugement.
La Cour d’appel admettait bien que le chef de rang faisait l’objet de réprimandes infondées de la part de la gérante du restaurant, qui l’avait notamment traité de « fainéant, bon à rien, laxiste, espèce de mou », « tronche de cake », et lui avait signifié que « on n’est pas au Portugal ici ».
Mais, la Cour d’appel estimait « que ces propos ne sont certes pas flatteurs mais, détachés de leur contexte, ne peuvent pas être catégoriquement qualifiés d’injurieux ». La Cour d’appel soulignait en outre « la relativité du caractère injurieux des termes tronche de cake », pour conclure finalement qu’il n’existait « pas en l’espèce d’élément faisant présumer que le salarié a subi un harcèlement moral » (CA Paris, Pôle 6, chambre 8, 10 Novembre 2016 – n° 15/06896).
Il faut sans doute lire « replacés dans leur contexte » plutôt que « détachés de leur contexte » dans le premier motif car, une fois cet abus de langage redressé, cette décision illustre la théorie de la relativité en droit du travail, ou le principe selon lequel, en cette matière, les injures s’apprécient différemment selon le contexte dans lequel elles sont proférées ; elles n’ont pas la même gravité selon qu’elles sont prononcées sur un chantier de BTP ou dans l’ambiance feutrée d’un salon de massage.
A chaque milieu professionnel son langage fleuri !Me Manuel DAMBRIN
-
Par CardinalAvocats le 10 Septembre 2017 à 20:44

L’ordonnance portant réforme du Code du travail relative à « la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » prévoit de fixer au niveau national le périmètre d’appréciation du motif économique lorsque le licenciement est prononcé par une entreprise appartenant à un groupe de dimension internationale.
Ce serait une petite révolution dans le contentieux du licenciement économique ! En effet, actuellement, l’un des arguments privilégiés – car l’un des plus efficaces - des salariés licenciés par la filiale française d’une multinationale pour contester leur licenciement économique consiste à soutenir que le motif économique n’est pas caractérisé au niveau mondial. Schématiquement, si la société française qui procède au licenciement accuse des pertes abyssales mais que la succursale allemande ou la filiale japonaise réalise des bénéfices, le licenciement opéré en France n’est pas justifié et ouvre droit à des dommages et intérêts.
Le nouvel article L.1233-3 du code du travail énoncerait : « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude » (art. 18 de l’ordonnance).
Cette limitation de l’appréciation du motif économique comporterait cependant une exception qui tient dans les deux derniers mots du texte : « sauf fraude ». Comme dit l’adage, « Fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout, pour ceux qui ont séché les cours de latin).
Autrement dit, le juge pourra continuer à contrôler les éventuels abus de droit ; il aura toujours la possibilité de conclure à l’absence de motif économique s’il lui apparaît, au besoin après avoir diligenté une expertise, que le groupe a artificiellement concentré les difficultés économiques sur les établissements français pour leur faire supporter les suppressions d’effectifs.
Me Manuel Dambrin
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique







