-
 Par la clause de mobilité le salarié accepte, par avance, que son lieu de travail puisse être modifié, par exemple en cas de déménagement de l’entreprise. A condition que sa mise en œuvre ne soit pas abusive et qu’elle corresponde à l’intérêt de l’entreprise, la mutation s'imposera au salarié et son refus de la nouvelle affectation pourra justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave.
Par la clause de mobilité le salarié accepte, par avance, que son lieu de travail puisse être modifié, par exemple en cas de déménagement de l’entreprise. A condition que sa mise en œuvre ne soit pas abusive et qu’elle corresponde à l’intérêt de l’entreprise, la mutation s'imposera au salarié et son refus de la nouvelle affectation pourra justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave.Encore faut-il pour cela que la clause de mobilité soit correctement rédigée et en particulier qu’elle précise son étendue géographique. Typiquement, une clause indiquant que le salarié pourra voir son lieu de travail transféré à n’importe quel endroit où l’entreprise est établie ou s’établirait à l’avenir, sans préciser de limite géographique, ne serait pas valable et ne pourrait donc être opposée au salarié.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (n°18-20353), le contrat de travail de la salariée (responsable de la région nord-ouest dans une société de vente d'accessoires de cuisine) prévoyait que « la société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ».
Pour valider cette clause et la déclarer opposable à la salariée, la Cour d’appel avait retenu qu'à ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d'intervention géographiques de R01 à R10, et que la mobilité était inhérente aux fonctions de la salariée, qui avait de ce fait par avance accepté que son secteur soit modifié, dans tout le territoire métropolitain.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge en effet que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et qu’elle conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, ce dont il résultait qu’elle n’était pas applicable et que le licenciement de la salariée au motif qu’elle avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation était abusif.
Me Manuel Dambrin
-
 Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral imaginé par la jurisprudence à la suite du scandale dit de l’amiante. Il s’agissait originellement de réparer la situation d’inquiétude permanente éprouvée par des salariés ayant été exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail et donc susceptibles de déclarer une maladie liée à l’exposition à l’amiante.
Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral imaginé par la jurisprudence à la suite du scandale dit de l’amiante. Il s’agissait originellement de réparer la situation d’inquiétude permanente éprouvée par des salariés ayant été exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail et donc susceptibles de déclarer une maladie liée à l’exposition à l’amiante.Initialement, seuls les salariés ayant travaillé dans certains établissements dont la liste était établie par arrêté ministériel pouvait se prévaloir de ce préjudice.
Puis, en avril 2019, la Cour de cassation a ouvert la possibilité d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété à tous les salariés démontrant qu’ils avaient été exposés à l’amiante, même s’ils n’avaient pas travaillé dans les établissements définis par l’arrêté ministériel (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442).
Un pas de plus est franchi avec l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 (n° 17-24879). Statuant dans une affaire concernant des mineurs exposés à des substances cancérogènes, la Cour de cassation leur a reconnu le droit d’agir en réparation du préjudice d’anxiété.
Désormais, la réparation du préjudice d’anxiété peut désormais être demandée en cas d’exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » ; tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique qui justifie subir un préjudice d’anxiété peut agir contre son employeur, à charge pour ce dernier de démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Ces mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1). En outre, l'employeur doit respecter certains principes de prévention : évaluer les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, etc. (c. trav. art. L. 4121-2).
Me Manuel Dambrin
-
Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon le 16 septembre dernier (Télécharger « Jgt.pdf ») pourrait n’être qu’anecdotique au regard des faits poursuivis : deux militants écologistes se sont introduits au sein de la mairie du 2ème arrondissement de Lyon le 21 février 2019, en pleine journée, puis ont emporté avec eux le portrait du président de la République se trouvant dans la salle de mariage, « dont la porte était fermée mais non verrouillée ». Ledit portrait a ensuite été exhibé à l’occasion de manifestations afin de dénoncer, selon les militants, l’inaction d’Emmanuel Macron face aux enjeux posés par le réchauffement climatique.
D’autres portraits du Chef de l’Etat étaient aussi brandis lors de ces rassemblements, provenant de « décrochages » réalisés dans d’autres bâtiments publics.
Les faits étaient avoués sans difficulté par les prévenus, et même revendiqués par ces derniers, qui ont fait de leur procès une tribune politique, citant comme témoins Cécile Duflot, ancienne dirigeante des Verts et ancienne ministre de l’environnement, ainsi que Wolfgang Kramer, « scientifique en écologie globale » (jugement, p. 5). Crânement, ils ont refusé de restituer le portrait afin de pouvoir l’utiliser à l’occasion d’autres manifestations.
Le procureur de la République requerrait une peine symbolique, la condamnation de chaque prévenu à une peine d’amende de 500 €.
Elle semblait en rapport avec la gravité de l’infraction, évidemment constituée, mais d’importance modérée.
Le Tribunal, constitué d’un juge unique, a pourtant relaxé les deux prévenus aux termes d’un jugement apportant un soutien explicite non seulement aux thèses des militants écologistes, mais aussi aux voies d’action choisis par ces derniers pour diffuser leur message.
En fait, dès l’audience, on pouvait considérer que le Tribunal soutenait la cause des prévenus, en laissant ces derniers, accompagnés de leurs témoins eux aussi militants, dévoyer le procès en meeting écologiste portant sur le dérèglement climatique, la prétendue inaction des dirigeants politiques, et singulièrement du président de la République française, pour y porter remède, et sur la légitimité d’actes de « désobéissance civile non-violente ».
Mais ce sont les motifs du jugement qui sont les plus stupéfiants.
En effet, le magistrat rédacteur aurait pu rendre un jugement lapidaire, relaxant les prévenus des faits de la cause sans s’expliquer extensivement sur les raisons le conduisant à rendre ce verdict.
Il a, au contraire, choisi de développer la motivation du jugement dans plusieurs paragraphes (rédigés de manière élégante) structurés selon la séquence suivante :
- Les faits reprochés sont constitués : « l’infraction de vol est matérialisée au regard des éléments rassemblés par l’enquête et des aveux recueillis à l’audience » (p. 6, § 3) ; « le dérèglement climatique est un fait constant qui affecte gravement l’humanité » (§ 4) ; les objectifs fixés par la France en vue de limiter le changement climatique ne seront pas atteints ; « le mode d’expression des citoyens dans un pays démocratique ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales » (p. 7, § 2) ; le décrochage et l’enlèvement du portrait « doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple » (p. 7, §3).
Cette décision témoigne de la désinvolture de certains magistrats à l’égard non seulement du devoir de réserve qui s’impose à eux en qualité de fonctionnaires, mais aussi de l’indépendance et de l’impartialité qui doit être la leur dans l’exercice de leurs fonctions.
Il ne s’agit évidemment pas de discuter leur droit d’avoir des opinions politiques, mais de rappeler qu’ils ne parlent pas pour eux-mêmes et rendent des décisions au nom du peuple français, au service d’une Justice qui les surplombe et les dépasse.
Au cas présent, le magistrat rédacteur (on ne peut plus écrire le « Tribunal correctionnel » car c’était manifestement un citoyen qui s’exprimait), a rendu un bien mauvais service à la justice, perpétuellement, et souvent injustement, soupçonnée de partialité. Pour cette raison, il est essentiel que le magistrat ait à cœur, d’une part, de prendre de la distance avec lui-même, d’autre part, de conférer à ses décisions une apparence d’impartialité et d’équilibre de nature à faciliter leur acceptation par les justiciables et par la société.
Cette décision illustre également une méconnaissance inquiétante de la séparation des pouvoirs prévue par nos institutions, le Tribunal n’ayant pas à trancher des questions de politique publique ni à juger des orientations gouvernementales.
Enfin, et c’est le plus grave sans doute, il est intolérable de lire que l’action illégale est le « substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple ». Le magistrat rédacteur foule aux pieds l’état de droit, comme si la République française n’était pas une démocratie, comme si le président de la République n’avait pas été élu (récemment) selon une procédure conforme à notre Constitution, comme si les Français ne disposaient pas de voies multiples et légales pour exprimer toute la diversité de leurs opinions.
Le portrait du président de la République n’est pas qu’une photo d’Emmanuel Macron, ainsi que l’a fort bien écrit Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans Le Figaro du 20 septembre 2019 : « Symbole du lien républicain unissant les citoyens en dépit de la diversité de leurs opinions, la présence du portrait du chef de l’Etat dans les hôtels de ville atteste, comme les emblèmes nationaux (hymne, drapeau), de notre attachement à un noyau consensuel d’affections et de loyautés. Ces symboles disent ce que nous avons de commun et qui nous met en mesure de débattre pacifiquement du reste. Y porter atteinte, c’est rompre ce lien et rendre par conséquent impossible la gestion des affaires communes ».
Me Xavier Chabeuf
-
Le 16 septembre prochain, les avocats manifesteront à Paris pour s'opposer au projet de réforme de leur régime de retraite.
Réflexe corporatiste ? Défense de privilèges ? Pas certain.
En effet, il est acquis que la réforme projetée affectera en tout premier lieu les régimes de retraites qui bénéficient de meilleures conditions que la plupart des salariés du secteur privé : taux de cotisation moindre, âge de départ à la retraite avancé, taux de remplacement de la pension élevé,...
Le régime de retraite des avocats connaît une situation bien différente, puisqu'il s'agit d'un régime autonome qui ne coûte rien à la collectivité et reverse même 80 millions d'euros par an au titre de la compensation démographique entre caisses de retraite.
Il est équilibré, comme devrait l'être tout régime de retraite par répartition, en ce sens que les cotisations perçues des avocats au cours d'une année servent les pensions dues au titre de la même année.
Il est prévoyant, car la Caisse nationale du barreau français (CNBF), qui gère ce régime, a mis en réserve près de deux milliards d'euros, fruit de l'épargne collective des avocats en vue de palier un éventuel retournement démographique de la profession, ce qui assure l'équilibre du régime jusqu'en 2054 pour le régime de base et jusqu'en 2083 pour le régime complémentaire.
Il est solidaire, car tous les avocats perçoivent la même pension de base.
Précisons, aussi, que la profession se caractérise par deux données :
- un âge moyen de départ à la retraite de 65,1 ans, ce qui explique sans doute l'équilibre du régime et les réserves constituées, CQFD;
- une espérance de vie à la retraite de 17,9 ans, contre 27,4 ans pour les autres retraités.
Ce régime de retraite est promis à la disparition à la suite de la mise en oeuvre du projet de réforme des régimes de retraite, dont les contours sont maintenant connus, même si des détails d'importance (notamment la période d'entrée en application de la réforme) restent à préciser.
La conséquence pour les avocats sera désastreuse :
- les réserves patiemment constituées au fil des années seront siphonnées par le futur régime ;
- le régime de base forfaitaire et solidaire garantissant une retraite de base identique pour tous les avocats, disparaîtra ;
- le niveau des pensions versées diminuera ou stagnera en fonction des revenus déclarés (au niveau médian de revenu des avocats, soit 43.000 €/an, les cotisations augmenteront de 110 % et les pensions de 1,2 %) ;
- le taux de cotisation passera de 14 à 28 %, les charges des avocats atteignant 60 % avant impôt.
A ce jour, rien ne justifie de supprimer le régime de retraite des avocats, si ce n'est la volonté de créer un seul système de retraite pour tous les Français.
Cette réforme, belle sur le papier, ne peut pas se faire en portant à ce point atteinte aux droits d'une profession.
Espérons que la concertation promise sera sincère et constructive.
Me Xavier Chabeuf
-
 En manière de licenciement disciplinaire et plus particulière de licenciement pour faute grave ou lourde, la preuve des faits fautif incombe exclusivement à l’employeur. C’est à lui de démontrer la réalité et la gravité des faits et non au salarié de démontrer qu’il ne les a pas commis.
En manière de licenciement disciplinaire et plus particulière de licenciement pour faute grave ou lourde, la preuve des faits fautif incombe exclusivement à l’employeur. C’est à lui de démontrer la réalité et la gravité des faits et non au salarié de démontrer qu’il ne les a pas commis.Aussi la question n’est-elle pas de savoir si les faits ont été commis mais s’il existe une preuve qu’ils ont été commis.
Dans cette affaire, il était reproché au salarié, veilleur de nuit dans un hôtel, d’avoir roué de coup sa collègue. La lettre de licenciement pour faute lourde énonçait :
« Le jeudi 13 octobre 2011, vers 18 heures 50, alors que vous étiez sur votre lieu de travail pour y accomplir vos attributions professionnelles de veilleur de nuit, vous avez porté des coups d’une particulière gravité sur la personne de votre collègue de travail, Madame G, qui occupe les fonctions de femme de chambre.
Alors qu’elle avait pris l’initiative de vous saluer dans le couloir de l’hôtel, vous vous êtes en effet énervé, sans aucune raison apparente et vous l’avez agrippée au niveau du cou puis, en la bloquant violemment sur la machine à café, vous l’avez frappée en lui portant à plusieurs reprises des coups de poing et de pied, non sans la gifler et lui cracher au visage.
(…)
Madame G A épouse H I était à moitié sonnée lorsque les pompiers, alertés entre-temps, sont intervenus sur place auprès d’elle, avant de la transporter à l’hôpital DELAFONTAINE à Saint-Denis, où elle fut hospitalisée jusqu’au 18 octobre à 10 heures.
Lors de cette hospitalisation, la victime devait subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle des broches furent placées dans l’épaule droite. Ces lésions devaient entraîner une incapacité totale de travail personnelle de 45 jours. (…) ».Les seuls éléments produits par l’employeur à l’appui de ce licenciement étaient le dépôt de plainte de la femme de chambre ainsi que le certificat médical constatant ses lésions.
Et ces éléments furent jugés insuffisants.
En effet, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié prétendait, pour sa défense, que sa collègue de travail était arrivée sur le lieu de travail en état d’ébriété et qu’elle avait perdu l’équilibre, ce qui avait occasionné ses blessures. Il alimentait le dossier en produisant des témoignages indiquant que l’intéressée était régulièrement dans un état d'ébriété ce qui lui avait valu plusieurs sanctions. En outre, le procureur avait classé sans suite la plainte au motif que « la victime par son comportement s’est rendue responsable de l’infraction dont elle se plaint ».
Il n’en a pas fallu davantage à la Cour d’appel pour juger que « Au vu des éléments précités, il s’avère que Maître Z ne rapporte pas la preuve que les lésions subies par Madame G résultent de violences exercées à son encontre par Monsieur Y. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l’intimé et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 22 juin 2017, n° 15/09443).
Me Manuel Dambrin
-
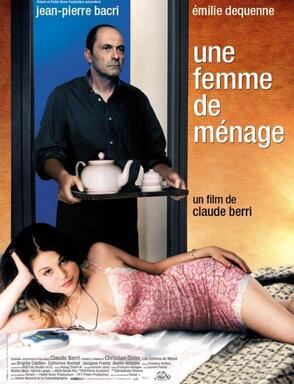 L’affaire est banale : un particulier embauche, sans contrat écrit, une employée de maison dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel (CESU). Après quelques temps l’employée ne se présente plus au travail et notre particulier employeur ne met pas en œuvre de procédure de licenciement pour abandon de poste. A quoi bon ? il cesse simplement de payer le salaire et voilà tout.
L’affaire est banale : un particulier embauche, sans contrat écrit, une employée de maison dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel (CESU). Après quelques temps l’employée ne se présente plus au travail et notre particulier employeur ne met pas en œuvre de procédure de licenciement pour abandon de poste. A quoi bon ? il cesse simplement de payer le salaire et voilà tout.Soutenant alors avoir été licenciée verbalement la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive).
De son côté, en défense, l’employeur lui reproche un abandon de poste et conteste toute imputabilité de la rupture du contrat de travail. Selon lui, il appartient à la salariée qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en apporter la preuve et le licenciement implique, de la part de l’employeur, une manifestation de mettre fin au contrat de travail qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
La cour d’appel rejette ces arguments, elle juge que la salariée a fait l’objet d’un licenciement verbal, donc forcément dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fait droit à ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts.
Cette solution est approuvée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juin 2019 (chambre sociale n° 17-27118), qui se situe dans le fil d’une jurisprudence classique : « Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Me Manuel Dambrin
-
 Le pouvoir disciplinaire de l’employeur a ses limites, dont deux sont bien connues.
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur a ses limites, dont deux sont bien connues.La première est que l’employeur ne peut plus sanctionner des faits plus de deux mois après qu’il en a eu connaissance ; cette règle réside dans l’article L.1332-4 du code du travail selon lequel « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
La seconde est contenue dans la formule latine « non bis in idem », qui exprime la règle selon lequel une personne déjà sanctionnée pour un fait ne peut l’être à nouveau pour le même fait. Par exemple, l’employeur ne peut, après avoir notifié un avertissement, prononcer ensuite un licenciement pour les faits qui ont donné lieu à l’avertissement.
Une autre règle est moins connue : en présence de plusieurs manquements constatés, si l’employeur décide de ne pas tous les sanctionner, il ne pourra pas sanctionner les autres ultérieurement, même si les deux règles précitées ont été respectées : il épuise son pouvoir disciplinaire avec la première sanction.
L’illustration de ce principe nous est donnée par un arrêt de la Cour de Grenoble du 27 juin 2019 (n° 17/02734).
Dans cette affaire, bien qu’informé de l’ensemble des faits susceptibles d’être reprochés au salarié, l’employeur avait décidé de ne lui notifier un avertissement que pour certains d’entre eux … puis il s’était ravisé et avait engagé un licenciement fondé sur ceux des faits qu’il n’avait pas sanctionnés mais qui étaient antérieurs à l’avertissement.Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, pour cette raison qu’en choisissant de notifier un avertissement à raison de certains faits seulement, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, y compris à l’égard des faits non sanctionnés puisqu’il en avait eu connaissance et avait été en mesure de les sanctionner.
La Cour de Grenoble applique ici une jurisprudence classique selon laquelle « l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction » (Cass. Soc., 16 janvier 2019, n°17-22557).
Me Manuel Dambrin
-
 Avec des températures avoisinant les 38°C (ressenties 48 C°) et la quasi totalité de la France classée en « alerte canicule », on peut se demander s’il est bien raisonnable de continuer à travailler pour certains corps de métiers particulièrement exposés à ces fortes chaleurs. On pense aux couvreurs et plus généralement aux métiers des travaux publics.
Avec des températures avoisinant les 38°C (ressenties 48 C°) et la quasi totalité de la France classée en « alerte canicule », on peut se demander s’il est bien raisonnable de continuer à travailler pour certains corps de métiers particulièrement exposés à ces fortes chaleurs. On pense aux couvreurs et plus généralement aux métiers des travaux publics.Si l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de garantir la santé de ses salariés, le code du travail ne prévoit aucune température « limite » à partir de laquelle il fait trop chaud pour travailler (la médecine du travail considère que des risques existent au-delà de 30°C, pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail physique).
C’est le fameux « droit de retrait » qui devra être utilisé par le travailleur qui estime, en son âme et conscience, que la poursuite du travail constitue un danger ou un risque pour sa santé.
Ce droit est prévu par l’article L.4131-1 du code du travail, qui énonce :
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ».Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre des salariés qui font usage de leur droit de retrait mais si l’employeur considère le retrait abusif, il reviendra au Prud’hommes de trancher la difficulté.
Me Manuel DAMBRIN
-
 La faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée limitée d’un préavis. Elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis (ainsi que le droit à l’indemnité de licenciement).
La faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée limitée d’un préavis. Elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis (ainsi que le droit à l’indemnité de licenciement).C’est l’application pure et simple de l’article L.1234-1 qui énonce que le salarié a droit à un préavis (ou à une indemnité compensatrice équivalente), « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ».
Mais il existe en droit du travail un « principe de faveur », énoncé notamment à l’article L. 2251-1 du Code du travail selon lequel : « La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ». Par extension, la « disposition plus favorable » peut également être contenu dans le contrat de travail.
C’est ce principe qui a été mis en œuvre dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 (n°17-26.999).
La société Faurecia sièges d'automobile avait licencié pour faute grave son directeur de la stratégie des achats famille et ne lui avait donc, ni permis d’exécuter son préavis, ni payé une indemnité compensatrice de celui-ci. L’enjeu n’était pas négligeable puisque le préavis était en l’espèce de 6 mois et représentait environ 150.000 €.
La Cour d’appel de Versailles donnait raison à l’employeur au motif que le préavis n'est pas dû en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement est motivé par une faute grave.
Mais cette décision est cassée.
En effet, le salarié soutenait que son contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'une ou l'autre des parties, le préavis sera de six mois sans l'exclure en cas de faute grave.
La Cour de Cassation en déduit que la Cour d’appel a dénaturé le contrat de travail qui prévoyait une disposition plus favorable et que le préavis était dû, nonobstant la réalité de la faute grave.
Il convient donc de veiller particulièrement à la rédaction du contrat de travail car celui-ci peut contenir des dispositions plus favorables à l’insu de l’employeur…
Me Manuel Dambrin
-
 La Cour de Cassation rappelle à nouveau que la rémunération au forfait-jours suppose que le salarié, cadre ou non cadre, soit autonome dans ses fonctions. A défaut, le forfait-jours lui est inopposable et l’intéressé est réputé avoir été soumis à la durée légale du travail (35h hebdomadaires) et peut prétendre au règlement d’heures supplémentaires (Cass. Soc., 27 mars 2019, N° 17-31715).
La Cour de Cassation rappelle à nouveau que la rémunération au forfait-jours suppose que le salarié, cadre ou non cadre, soit autonome dans ses fonctions. A défaut, le forfait-jours lui est inopposable et l’intéressé est réputé avoir été soumis à la durée légale du travail (35h hebdomadaires) et peut prétendre au règlement d’heures supplémentaires (Cass. Soc., 27 mars 2019, N° 17-31715).Dans l’affaire qui a donné lieu à ce rappel, le salarié, employé en tant que « concepteur son événementiel » au sein de la société Euro Disney avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour des repos compensateurs non pris, une indemnité pour travail dissimulé.
En principe la clause de rémunération au forfait-jours qu’il avait signé s’opposait à ces demandes.
Mais la Cour d’appel y fait cependant droit en relevant que les « conceptions audio des événements » étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant contactaient le salarié pour vérifier avec lui la faisabilité d'une proposition ou recueillir son avis de technicien, de sorte qu'il n'intervenait en réalité qu'en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d'innovation technique, qu'il n'établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements, qu'il procédait à la mise en œuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière...) et qu'il avait un responsable sur place.
Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté, la Cour de Cassation ajoutant que les fonctions du salarié s'appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable, que des plannings précis comportaient notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations à respecter afin que l'événement se déroulât bien et laissât la place au suivant ; qu’en conséquence, le salarié ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l'employeur, et ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.
Rappelons que le critère de l’autonomie n’est pas la seule condition que doit remplir le forfait jours pour être valable. Celui-ci doit, avant tout, être prévue par un accord collectif qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail et des repos, journaliers et hebdomadaires, être stipulé dans un écrit auquel le salarié a donné son accord, et faire l’objet d’entretiens annuels portant sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié (voir précédents posts sur ce blog).
Me Manuel Dambrin








